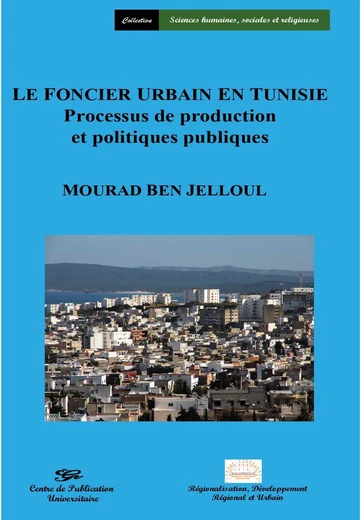Dans les villes des pays du sud, les populations urbaines continuent d’augmenter à des rythmes soutenus. en effet, une extension urbaine considérable a été enregistrée durant les dernières décennies à la suite, entre autres, de la généralisation de l’habitat individuel. de ce fait, un processus d’étalement urbain sans précédent a vu le jour, avec une multitude de formes d’appropriation et de production de l’espace urbain, le tout dans un contexte dominé par la progression des marchés fonciers non régulés. l’étalement urbain et la périurbanisation ont placé la question foncière au coeur des préoccupations de nombreux acteurs : promoteurs fonciers et immobiliers, lotisseurs réglementaires et informels, propriétaires fonciers, spéculateurs, collectivités locales et autorités centrales. pour l’étalement urbain, l’entrée foncière permet d’étudier la question de la production foncière sous ses diverses formes et selon ses différents acteurs. la question de la « consommation foncière » résulte essentiellement de la périurbanisation. le foncier urbain, avec tous les problèmes qu’il pose pour les pouvoirs publics comme pour la population et les différents acteurs de la production foncière et immobilière, est devenu l’un des domaines caractéristiques des grandes villes, étant donné que l’accroissement de l’agglomération urbaine entraîne la raréfaction du sol urbain et l’augmentation de ses coûts et en conséquence le développement du processus de fragmentation et de ségrégation socio-spatiale. ainsi, l’accès au sol urbain devient l’obstacle majeur pour la plupart de ceux qui appartiennent à la catégorie des exclus de la ville et qui veulent y construire un logement ou ceux qui n’ont pas pu en avoir un, à cause de l’insuffisance de l’offre de logement par les filières réglementaires. cette situation exerce des pressions énormes sur le marché foncier entraînant de très fortes spéculations sur le sol urbain et ouvrant la voie au développement du secteur informel et en conséquence à une prolifération de l’habitat non réglementaire. ainsi, comme l’explique michel rochefort « le premier obstacle pour les populations démunies est dû aux conditions d’accès au sol urbain. sous leur forme légale, les lotissements aménagés sont trop chers et réservés aux classes aisées. les propriétaires des terres agricoles aux abords des grandes villes ne peuvent pas espérer une valorisation totale par ce processus. ils pratiquent alors des « lotissements clandestins » où le terrain est divisé en parcelles sans aucune infrastructure d’accompagnement et les lots vendus à bas prix à une population qui y construit sa propre maison de dimension réduite, sans confort, mais relativement solide. les pratiques varient : le grand propriétaire terrien d’amérique latine ne se comporte pas comme le chef coutumier traditionnel d’afrique ou le petit paysan du monde arabe et de l’asie » (rochefort, 2000, p.47). pour la tunisie, la question foncière urbaine a représenté, depuis des décennies, un des problèmes majeurs de l’urbanisation et un handicap de taille pour les différents acteurs du secteur de la production foncière et immobilière. cette situation s’explique par l’importance des pressions exercées sur les villes, depuis l’indépendance, et l’incapacité des pouvoirs publics à répondre à ces pressions en présentant un produit adapté aux besoins diversifiés des populations. en effet, la tunisie est parmi les pays les plus anciennement urbanisés en afrique et dans le monde arabe. elle est aujourd’hui parmi les plus urbanisés avec un taux de 67,8% en 2014 (ins, 2014), alors qu’elle ne dépassait pas les taux de 28% en 1925. au cours des trente dernières années, elle a connu de multiples transformations, tant au niveau de l’organisation spatiale de ses villes qu’à celui de leur contenu socio-économique et des pratiques sociales des habitants. les premiers résultats du recensement de la population et de l’habitat organisé au mois d’avril 2014 confirment les tendances déjà enregistrées lors des précédents recensements. la population tunisienne, qui a dépassé pour la première fois de son histoire les 10 millions d’habitants en 2005, atteint en 2014 10 982 754 habitants ; le nombre d’habitants du grand tunis s’élève à 2 643 000 (ins, 2014) et plus de 70% des ménages (70.2%) vivent en milieu urbain. ce dernier abrite 71,2% du parc logements, soit 1 903 700 unités contre seulement 696 000 logements en 1984 (soit une augmentation de 173% en 30 ans), avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan de la croissance spatiale des villes : accentuation des phénomènes de la périurbanisation et étalement spatial, épuisement des réserves foncières des opérateurs publics et développement des divers modes de production foncière informelle. cette pression exercée sur le marché foncier a eu des conséquences négatives sur le fonctionnement de ce marché : les prix du sol urbain augmentent à un rythme accéléré et continu et l’habitat spontané prolifère. ainsi, le principal opérateur foncier public, à savoir l’agence foncière d’habitation (afh) a enregistré 321 000 demandes de lots de terrains de la part de citoyens tunisiens, alors qu’elle n’a pu satisfaire que 76 794 demandes, c’est-à-dire seulement 24%. les plus fortes demandes de terrains sont enregistrées dans le grand tunis (183 000 demandes et un taux de satisfaction de seulement 19%) et au centre est (46 000) soit respectivement 57 % et 14% de l’ensemble de la demande (kahloun, 2014). la production de logements par le secteur public n’a pu répondre qu’à une partie minime de la demande et ne représente que 2,5% de l’ensemble de la production immobilière. le secteur de la promotion immobilière capitaliste, malgré un développement notable de son activité lors de la dernière décennie, n’a pu dépasser le taux de 22% de la production immobilière formelle (contre 75% pour le secteur de l’autopromotion et 3% seulement pour le secteur public). son produit est orienté, en premier lieu, vers le haut standing (65% de sa production) et donc au profit des classes les plus solvables, et, en second lieu, vers les franges supérieures des classes moyennes (33% de sa production est de type économique). enfin, le logement social ne représente que 2% de son activité (gdoura, 2014). en conséquence, l’incapacité de l’appareil public quant à la production de terrains et de logements en mesure de répondre, en quantité et en qualité, aux besoins pressants des classes populaires et, par ailleurs, l’orientation de l’activité des sociétés de promotions immobilières privées vers les classes les plus solvables, expliquent le recours massifs, aux filières non réglementaires. ainsi, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, ce secteur informel aurait représenté pour tout le pays 40% des opérations de construction, en fournissant des logements à un coût inférieur de 40% à celui du secteur légal (troin, 2000). pour le grand tunis, les statistiques des années 1980 donnent des pourcentages de 33% (le taux maximum est atteint dans le gouvernorat de l’ariana avec 51,46%), alors que, pour les lotissements non réglementaires, la part s’élève à 54% des terrains urbanisés. lors des années 1990, sur les 50 000 logements construits chaque année en tunisie, près de 25% sont des logements informels (rapport de la commission ad hoc pour une stratégie de l’habitat, meh, juin 1988). cette croissance de plus en plus importante du secteur informel est due, entre autres, aux difficultés d’accès au foncier urbain et à sa production.