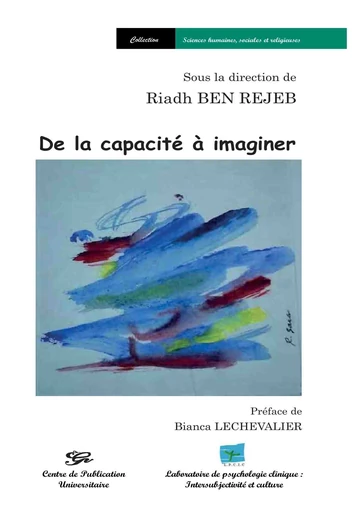Mots clés
De la Capacité À Imaginer
Détails de la publication
Capacité,imaginer
Préface
Les neurosciences, actuellement, mettent en exergue des réseaux plutôt que des sites cérébraux. ainsi la « capacité à imaginer » mobilise l'associativité de circuits neuronaux, avec un rôle privilégié pour le cortex préfrontal. celui‐ci a ainsi une fonction essentielle pour la créativité. la créativité, la capacité à imaginer 'est pas seulement une liaison d'images ; elle est faite, d'après ces données neuroscientifiques, d'idées, de projets d'action et de souvenirs, voire de traces mnésiques. l'imagination peut différer de la créativité : elle peut ne consister qu'en l'évocation d'images de façon statique. narcisse, contemplant son reflet dans l'eau en serait un exemple. nous pourrions encore évoquer le paranoïaque répétant toujours la même image persécutrice, les images idéologiques figées et répétitives, les idoles statiques... ces images fixes mettent en jeu d'autres régions cérébrales davantage postérieures qui servent à se représenter. sont alors activées les régions occipitales pour la vision et temporales pour les images auditives. mais il existe des réseaux inhibiteurs qui peuvent aussi interférer. la capacité à imaginer 'est donc pas que la fonction qui consiste à recevoir et produire des images. son rôle principal est la créativité. la créativité est guidée vers un but. ainsi, si la créativité ne peut pas se passer d'imagination, l'imagination peut se dérouler sans créativité. la capacité à imaginer est un processus transformateur de la pensée. nous voici proche de la théorisation de w. bion pour qui la pensée lie, corps, émotion et symbole dans une mobilité transformatrice du monde interne. l'ouvrage dirigé par riadh ben rejeb nous amène depuis narcisse fixé sur son reflet dans l'eau, jusqu'à une polyphonie culturelle. nous voici au coeur de « la capacité à imaginer » avec sa richesse dans le temps et l'espace. nous pourrions à sa citation de la bible au début de son texte, ajouter le passage concernant la réception de la loi par les hébreux. la phrase énonce : « ils virent des voix ». elles devinrent écriture sur les tables. nous voici dans la mobilité polysensorielle qui accède à la polysémie de la symbolisation avec l'écriture. r. ben rejeb, fait très justement référence à freud privilégiant l'écoute plutôt que la vision. wahid essaafi, à propos de la création de la femme, nous montre le jeu de mots sumériens entre «côte » et « vie ». la bisexualité est ainsi en jeu dans l'oeuvre de vie. enfin dans le même texte, la citation de bottéro, (p. 136) spécialiste des écrits de la créativité mésopotamienne, nous conduit à l'inachevé... il parle d'une pensée « qui, N'ayant pas encore réduit les idées pures ni appris à construire les raisonnements formels, procédait par images et par enchaînements d'imaginations, recherchant beaucoup moins la génétique contrôlée et objective d'une donnée de fait que la suite d'évènements, reconstruits avec plus ou moins de fantaisie, qui suffisait à en rendre raison ». la capacité à imaginer est inachevée et abolit les limites de la répétitivité, elle est hors du temps et de l'espace. elle peut dépasser la pensée logique secondarisé pour plonger dans les profondeurs de l'inconscient. n. geblesco introduit l'importance du fantasme. celui‐ci peut consister en une fantaisie, une rêverie consciente. mais si on se réfère au terme anglais « phantasme » avec « ph », nous voici dans une problématique inconsciente. s. isaacs (1952)1 nous a montré combien le phantasme s'enracine dans les émotions du corps, et combien il peut être précoce, avant l'organisation d'un langage secondarisé. elle nous décrit un bébé de 18 mois terrorisé par la semelle d'une chaussure qui baille. plus tard après l'âge de 2 ans, l'enfant expliquera que la chaussure pouvait la manger. l'écartement de la semelle donnait l'image d'une gueule dévorante. nous voici dans la projection identificatoire et le phantasme. la capacité à imaginer et ses phantasmes intègrent le corps et la communication non verbale. lorsque la communication non verbale conduit à la narration, elle permet le travail du récit du rêve. le travail du conte est proche du travail du rêve avec les mécanismes de condensation, de déplacement, de représentation du contraire, etc. il permet de mettre en scène les phantasmes de désir, de figurer les pulsions monstrueuses. la semelle de chaussure qui baille est proche des ogres ou sorcières. le conteur permet l'accès à la narration et à la transformation des contes selon les époques, les publics, les cultures. un nouvel espace imaginaire est créé, espace partageable et transformable, espace qui transmet les récits immémoriaux d'une culture. nous voici à l'interface de l'individuel et de la culture dans un processus de transmission intergénérationnel. des idéaux sont ainsi véhiculés. la capacité à imaginer d'une société qui s'exprime ainsi, permet sa survie à travers guerres et destructions. les processus identificatoires et leurs transformations ont un pouvoir thérapeutique sur le plan collectif comme individuel. ces vertus thérapeutiques, peuvent être appliquées comme le développe r. ben rejeb. nous avons pour notre part utilisé1 l'espace du conte au centre médico psycho pédagogique de l'université de caen pour des jeunes enfants au langage pauvre, et à la vie fantasmatique limitée dans leur environnement culturel privilégiant un fonctionnement opératoire. le travail en groupe avec une conteuse et une psychothérapeute se faisait en présence de leurs mères.avec le jeu du sable, la communication non verbale permet, comme nous le montre l. tarantini, la rencontre et la mise en scène de processus inconscients et le partage essentiel de l'affect. l'affect est au coeur du phantasme en action dans le processus créateur de la capacité à imaginer. cet ouvrage nous permet de le rencontrer dans un vaste espace communiquant où des personnages comme maïmonide et saint augustin se rencontrent et dialoguent avec freud et l'enfant du « for‐da ». celui‐ci met en scène le retour de l'objet, la propre existence du sujet en quête d'objet, et sa disparition possible dans l'image du miroir. le pouvoir d'enveloppement des images, comme nous le montre r. latiri, constitue un parexcitation, un accès au sens des émotions indicibles inscrites dans le corps et transmises à travers les générations. le sujet peut, luttant contre la destructivité, se rassembler. il accède à l'existence.
| Titre | ISBN | Volume |
|---|
| Titre | ISBN | Langue |
|---|