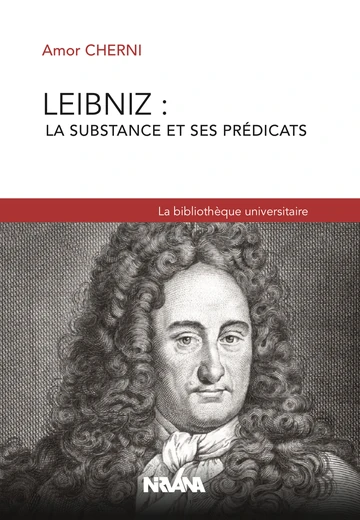Avant-propos
pour situer la pensée de leibniz par rapport à ses prédécesseurs, yvon belaval l’a souvent présentée, comme le versant d’un ta- bleau dont l’autre est représenté par la philosophie de descartes1. il insiste sur la différence de formation et de tempérament entre les deux philosophes, laquelle différence se reflète surtout sur leur at- titude à l’égard des vérités de la foi, que descartes met entre pa- renthèses et écarte du domaine de la raison, et que leibniz consi- dère comme l’un des éléments de sa pensée. une autre différence, non moins essentielle, caractérise l’attitude doctrinale de l’un et de l’autre: leur position à l’égard de l’antiquité et du moyen âge que descartes, comme on le sait, récuse et rejette et que leibniz réanime et fait revenir sur la scène de la modernité. belaval rappelle, entre autres choses, qu’avant de connaître la pensée de descartes (lors de son voyage et de son séjour à paris entre mars 1672 et octobre 1676, séjour entrecoupé par un voyage à londres de janvier à mars 1673), leibniz a déjà écrit le de arte combinatoria (1663-66), s’est occupé des demonstrationes catholicæ (1666-79), s’est engagé dans la phy- sique (hypothesis physica nova (1670)) où il dialogue avec hobbes et qu’à paris même, il a écrit la confessio philosophi, ébauche de la théodicée. il avoue lui-même n’avoir lu descartes que tardive- ment; mais cette lecture qui s’est faite précisément lors de ce même séjour à paris, a coïncidé avec son initiation aux mathématiques.
c’est, en effet, la lecture de la géométrie de descartes qui semble avoir été l’occasion de sa rencontre avec les mathématiques. or, un tel ouvrage n’est pas de nature à séduire l’esprit du jeune philosophe, déjà gagné à la méthode combinatoire, à la démarche formelle et
1 cf. y. belaval, leibniz critique de descartes, gallimard, 1960 et leibniz, de l’âge classique aux lumières, édité et présenté par m. fichant, paris, beauchesne, 1995 et notamment leibniz face à descartes, p. 59 sqq. et leibniz et descartes, p. 75 sqq.
11
syllogistique de par sa formation scolastique et ses attaches aristoté- liciennes, et tourné vers l’analyse et l’algèbre comme vers un idéal de vérité. la conséquence en a été le rejet immédiat de la méthode car- tésienne fondée sur le doute méthodique (dans lequel leibniz voit plutôt un amusement qu’un véritable effort de l’esprit) et sur le cri- tère géométrique et euclidien de l’évidence intuitive (qui lui semble être un critère arbitraire et dénué de garantie sinon de preuves lo- giques).
l’ensemble de cette situation est généralement désigné par les his- toriens comme étant une opposition entre l’intuitionnisme et le for- malisme, entre l’évidence mathématique et la preuve logique ou syllogistique. en d’autres termes, si descartes a rejeté la logique parce qu’étant à ses yeux un art plutôt d’exposition que de décou- verte (voir sa remarque sur « l’art de lulle »), leibniz réintroduit la logique comme la voie royale, non seulement de l’invention mais même et surtout de la pensée, étant entendu que penser, pour leib- niz, signifie d’abord et avant tout envisager tous les cas possibles, tous les points de vue soutenables sur une question et les ordonner se- lon des principes, dont le plus important est celui de la continuité. on peut résumer cette divergence et la simplifier à l’extrême en disant que si le modèle adopté par descartes pour sa démarche intellec- tuelle est représenté par la métaphore du chemin (en l’occurrence du chemin droit: le fameux exemple de celui qui se perd dans une forêt), le paradigme leibnizien se laisse représenter par celle de la trame ou de la structure (disposition, texture, contexture); bref ensemble de chemins tantôt convergents, tantôt divergents; qui se ressemblent et se distinguent à la fois, selon le principe de continuité auquel s’ajoute celui des indiscernables.
mais le critère cartésien de l’évidence est encore suspect aux yeux de leibniz en raison de l’attachement de celui-ci, encore une fois, à la scolastique et à la religion chrétienne, puisque ce critère, descartes n’a cessé de le répéter, ruine à partir de leur fondement l’autorité et la dévotion au passé. leibniz, élève de jakob thomasius, qui a tenté
12
une histoire non des philosophes mais de la philosophie, était épris d’histoire et loin de penser que le passé de l’humanité n’est qu’un simple tissu d’erreurs et de préjugés. pour lui, vérité et erreur, passé et avenir, foi et savoir ne sont nullement séparables comme blanc et noir. bien au contraire, le principe de continuité impose une progres- sion “par degrés insensibles” (expression qui prendra tout son poids au siècle suivant chez des auteurs aussi opposés que charles bonnet et denis diderot) entre les contraires, progression qui doit passer par tous les cas intermédiaires et convertir les contraires les uns dans les autres. si la pensée cartésienne est une pensée de dichotomie et d’opposition, celle leibniz est une pensée de la conciliation et de la nuance.
ce contraste prendra toute son ampleur dans le cadre da la philoso- phie de la nature et surtout à propos du mécanisme.
celui-ci est entièrement fondé chez descartes, comme on le sait, sur l’opposition radicale entre esprit et matière, âme et corps, pensée et étendue. le succès du cartésianisme, à son époque comme ultérieure- ment, tient à son innovation majeure consistant dans l’épuration du monde physique de toute intervention des forces occultes, des archées du moyen âge et des formes substantielles d’aristote. le monde maté- riel apparaît alors comme un ensemble de corps étendus, exclusivement ordonnés par le mouvement local qui, certes, procède de dieu comme de sa cause première, mais qui reste constant à travers sa communi- cation parmi les corps (la grande loi de conservation du mouvement). or, en contestant, au nom du principe de continuité, l’opposition car- tésienne, leibniz réintroduit l’esprit dans la matière et la pensée dans l’étendue. son allégeance à aristote et aux formes substantielles est non seulement établie, mais même revendiquée. tout cet aspect de sa philosophie, leibniz l’élabore à deux niveaux complémentaires: en amont, pourrait-on dire, à travers sa célèbre théorie de l’harmonie préétablie, qui se fait relayer par celle de l’harmonie universelle et, en aval, par le concept de substance simple ou monade. la première veut qu’il y ait non seulement contiguïté mais aussi correspondance
13
entre esprit et matière, âme et corps et toutes les substances peuplant l’univers. le second établit que chaque point du réel, chaque atome du monde est à la fois spirituel et matériel et que ces deux dimensions ne sont pas des réalités séparées ou séparables même en raison, mais deux aspects d’une même réalité. d’où il résulte que le mécanisme n’est pas faux, mais incomplet; qu’il n’épuise pas la réalité des choses et qu’il doit être, par conséquent, complété par ce que descartes pense être son opposé et qui n’est que son frère jumeau, à savoir le finalisme.
la même attitude sera observée à l’égard du monde vivant où leib- niz se dressera contre la théorie cartésienne des animaux-machines pour soutenir ceux qui militaient en faveur de « l’âme des bêtes » et appuiera fortement la notion d’échelle des êtres2, toujours en accord avec les principes de continuité et des indiscernables. ces deux prises de position montrent déjà une démarcation assez forte par rapport à descartes, puisqu’elles aboutissent à une claire dénonciation de la cou- pure cartésienne entre l’homme et les autres créatures, assimilées à de simples machines. et cette démarcation ne laissera pas de se renforcer par l’intérêt que leibniz ne cessera de porter aux animalcules, intérêt qu’il présentera, encore une fois, comme une revanche sur descartes et l’esprit spéculatif, au profit de l’observation et de l’expérience. a christian huyghens, il écrira :
j’aime mieux un leeuwenhoek qui me dit ce qu’il voit qu’un cartésien qui me dit ce qu’il pense3.
en tout cela leibniz reste fidèle à sa formation et à ses convictions de jeunesse, attaché au logicisme et au formalisme scolastique d’une part, et à sa foi luthérienne de l’autre. le cartésianisme lui paraît être, au même titre que le spinozisme, une menace dangereuse au dogme religieux et une porte ouverte à l’hérésie et à la libre pensée.
il apparaît donc qu’une bonne part de la pensée de leibniz est tri- butaire de son rapport à descartes, rapport ambigu et ambivalent,
2 cf. a. o lovejoy, the great chain of being, harvard university press, 1936 (ninith printing, 1970), ch. v, p. 144 sqq.
3 a ch. huyghens, 20-30 fév. 1691, g., math., v, p. 85
14
puisqu’il ne faut tout de même pas perdre de vue ce “truisme” rap- pelé par belaval, à savoir que “leibniz venant après descartes, ne peut être anticartésien, quand il l’est, que par descartes”4. et de fait, leibniz ne manque pas de rendre hommage à son prédécesseur, chaque fois qu’il en a l’occasion. a la fin de sa vie, confronté à la dure et laborieuse querelle contre les newtoniens, dont le porte-pa- role était samuel clarke, il se repliera sur des positions franchement cartésiennes et ne trouvera rien d’autre à opposer à l’attraction que la théorie des tourbillons et de la matière subtile. de même que l’on peut rappeler qu’en dépit de ses déclarations « tonitruantes » en fa- veur de la foi protestante et de ses insinuations et même de ses ac- cusations à l’encontre de descartes et des cartésiens, coupables, à ses yeux, de libre-pensée et de matérialisme pour avoir affaibli le pou- voir de dieu dans la nature, il est allé, lui, plus loin qu’eux, en sou- mettant dieu à sa sagesse et aux vérités éternelles5, pour ne rien dire du problème du mal que dieu a, selon lui, « toléré » faute d’avoir pu le « supprimer ».