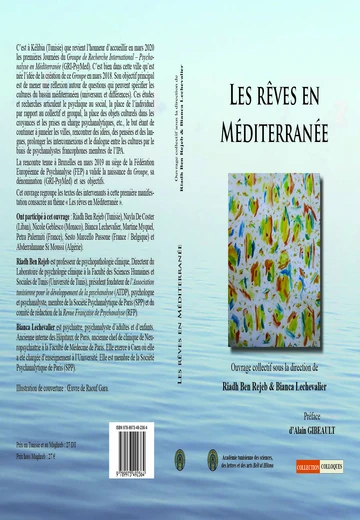Préface
alain gibeault*
« qu’est-ce que la méditerranée ? mille choses à la fois. non pas un paysage, mais d’innombrables paysages. non pas une mer, mais une succession de mers. non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres ».
fernand braudel, 1985, p.16.
ce livre au titre énigmatique, « les rêves en méditerranée », rassemble les communications qui ont fait l’objet d’un colloque en mars 2020 à kélibia en tunisie à l’initiative des deux co-fondateurs d’un groupe de recherche international - psychanalyse en méditerranée (gri-psymed), deux psychanalystes membres de la société psychanalytique de paris : riadh ben rejeb de tunis et bianca lechevalier de caen. pourquoi énigmatique ? comme le rêve est universel, est-ce qu’il y aurait une spécificité du travail du rêve, tel que découvert par freud à vienne à la fin du xixe siècle, chez les peuples du pourtour du bassin méditerranéen ? qui plus est, peut-on parler d’une identité méditerranéenne et d’une spécificité de la psychanalyse en méditerranée dans sa théorie et sa pratique ? c’est le défi qu’ont relevé les deux co-fondateurs et qu’ils évoquent dans leurs propos introductifs du livre. les textes ici publiés tentent de répondre à ces interrogations et d’ouvrir un champ de réflexions pour les années à venir.
comme le souligne l’historien fernand braudel (1985), la méditerranée est un « très vieux carrefour » de l’humanité : « dans son paysage physique comme dans son paysage humain, la méditerranée carrefour, la méditerranée hétéroclite se présente dans nos souvenirs comme une image cohérente, comme un système où tout se mélange et se recompose en une unité originale » (pp. 17-18). il ajoute que si la mer peut être considérée comme un « réservoir nourricier », elle a été longtemps un obstacle suscitant une « navigation prudente… qui colle au rivage » (p. 56). mais elle est devenue progressivement « un lien », une « surface de transport, une surface utile, sinon parfaite » (p. 55) : cette mer intérieure a ainsi favorisé les échanges entre les peuples et les hommes à tous les niveaux économiques, sociaux et culturels.
c’est aussi dans sa proximité et sur ses rives qu’a été inventée l’écriture, d’abord l’écriture cunéiforme sumérienne en mésopotamie avant la fin du ive millénaire av. j.-c., puis l’écriture hiéroglyphique égyptienne, probablement influencée par la précédente, à peu près à la même époque. les autres écritures du monde, en particulier l’écriture chinoise ancienne, attestée à partir de la fin du iie millénaire av. j.-c., sont plus tardives. cette invention a été majeure pour déterminer la limite entre la préhistoire, certes caractérisée par des productions artistiques et symboliques mais sans écriture connue, et l’histoire qui est le propre des sociétés avec écriture et de ce fait précisée grâce à la transmission de textes écrits.
l’un des articles de ce livre, « l’épopée de gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir », de nayla de coster témoigne de ce rôle immense joué par l’invention de l’écriture. cette épopée s’inscrit d’abord dans une tradition orale qui a été rédigée ensuite en caractères cunéiformes sur des tablettes d’argile au début du iie millénaire av. j.-c. l’épopée est un récit sur la condition humaine et ses limites, la vie, la mort, l’amitié et plus particulièrement un récit d’apprentissage sur l’éveil de son héros à la sagesse : après plusieurs péripéties qui fonctionnent comme des rites de passage, le héros gilgamesh rencontre des succès mais aussi des échecs, l’expérience de la mort et l’acceptation de celle-ci, et ainsi gagne en maturité et en sagesse.
mais ce qui est remarquable dans ce récit qui fait partie des œuvres les plus anciennes de l’humanité, c’est la place importante donnée aux rêves et à leur interprétation. nayla de coster évoque les deux rêves de gilgamesh racontés à sa mère et interprétés par elle. dans cette tradition antique, les rêves sont prémonitoires et l’interprétation de ces deux rêves vise à rassurer le héros d’une angoisse concernant un danger imminent par la rencontre d’un ami et double du héros, enkidu. il est intéressant de remarquer que déjà l’interprétation traduit une attention à la déformation du rêve, car le contenu manifeste, négatif, est interprété comme un contenu latent positif.
mais cette épopée contient beaucoup d’autres rêves, en particulier au cours d’un voyage initiatique du héros dans son combat contre les « monstres » (humbaba et le taureau céleste) : des rêves qui évoquent souvent la lutte contre la mort et l’effroi, beaucoup plus proches d’un cauchemar qui réveille (une montagne qui lui tombe dessus, une tempête avec des éclairs et du feu, un géant terrifiant, etc.), que d’un bon rêve « gardien du sommeil », selon l’hypothèse initiale de freud du rêve comme satisfaction hallucinatoire d’un désir infantile. dans ce voyage, les rêves de gilgamesh sont en soi effrayants et sont racontés à son ami enkidu, qui utilise la méthode connue du « renversement des valeurs » : le danger vu en songe renvoie, dans la réalité future, à une issue favorable, en particulier à la victoire contre l’ennemi humbaba, le gardien de la forêt.
mais le rêveur et son interprète changent au cours de ce voyage épique, lorsque son ami enkidu apprend en rêve qu’il est condamné par les dieux à mourir prématurément. dans cette situation, c’est gilgamesh qui interprète ce rêve en lui suggérant que tout rêve inspirant un malaise se rapporte à un sujet destiné à échapper à l’inquiétude par sa bonne santé promise (bottéro, 1992, p. 138, n. 1). nous pourrions faire l’hypothèse que ce n’est pas tant le contenu du rêve, quel qu’il soit, qui semble être la satisfaction du désir, mais le fait que le rêveur existe rêvant ; c’est ce désir-là qui semble d’abord satisfait.
mais le principe du bon rêve prémonitoire est ici tout de même mis en cause, car il est évident que dans ce passage, gilgamesh ne se fait guère d’illusion sur le caractère fatal du rêve : non seulement il implore des dieux la pitié, donc la vie sauve pour son ami, mais il professe qu’il lui faut s’abandonner au destin irréformable (bottéro, idem). la mort de son ami enkidu fait prendre conscience au héros que la mort existe, d’où son errance pour retrouver un vieillard immortel, utanapisti, et sa quête de l’immortalité : gilgamesh fait à nouveau des rêves terrifiants, mais apparemment sans personne à qui les raconter, ce qui le plonge dans une angoisse plus profonde. le désespoir de gilgamesh suggère l’envahissement par l’angoisse d’anéantissement alors que le voyage précédent le confrontait davantage à l’angoisse de castration. gilgamesh ressent un « silence de mort », ce qui évoque l’idée que l’angoisse la plus inquiétante est celle de l’absence de représentation comme dans le désinvestissement psychotique. gilgamesh touchera tout de même au but, mais le vieillard immortel le renverra à la désillusion dans sa quête de l’immortalité : « les grands-dieux rassemblés…nous ont imposé la mort comme la vie, nous laissant seulement ignorer le moment de la mort » (l’épopée de gilgamesh, p.182).
dans les textes présentés dans cet ouvrage, plusieurs auteurs ont souligné l’importance des rêves prémonitoires et prophétiques dans l’antiquité, correspondant à la pensée magique et à la toute-puissance de la pensée dans la réalisation des désirs inconscients. mais cette œuvre littéraire inaugurale qu’est l’epopée de gilgamesh montre l’intuition, à l’aube des sociétés avec écriture, de l’importance d’un travail du rêve et d’une expérience du rêve. c’est ce que soulignent en particulier les articles de bianca lechevalier sur la fonction des images oniriques pour lier l’excitation pulsionnelle, de nicole geblesco sur les rêves prophétiques qui dans la bible et le coran sont aussi des rêves de désir, de riadh ben rejeb qui souligne que les limites entre rêve et prophétie ne sont pas si clairs comme le montre l’expérience de l’istikhâra, l’exemple d’une consultation divine en islam qui passe par le sommeil et le rêve.
mais les mêmes auteurs rappellent l’enjeu de la découverte par freud d’une méthode d’interprétation des rêves visant moins la prédiction du futur que les retrouvailles avec un passé refoulé ou clivé. d’ailleurs freud (1925) s’est toujours montré critique à l’égard de l’interprétation prophétique des rêves : « qu’il y ait des rêves prophétiques, en ce sens que leur contenu présente quelque mise en forme de l’avenir, cela ne fait pas l’ombre d’un doute ; il reste seulement à se demander si ces prédictions concordent de quelque manière remarquable avec ce qui se produit effectivement plus tard. j’avoue que dans ce cas ma résolution d’impartialité m’abandonne » (p. 185). il avait pris cette position dès le début de son œuvre : « la formule propre à ces rêves s’énonce ainsi : ils sont des accomplissements voilés de souhaits refoulés. il est ici intéressant de remarquer que l’opinion populaire a finalement raison quand elle fait bel et bien annoncer l’avenir par le rêve. en vérité l’avenir que nous montre le rêve n’est pas celui qui va arriver, mais celui que nous aimerions voir arriver ainsi. l’âme populaire procède ici comme elle a par ailleurs l’habitude de le faire : elle croit ce qu’elle souhaite » (freud, 1900, p. 59). c’est l’enjeu de la pensée magique que freud approfondira ultérieurement dans totem et tabou.
dans son article, sesto marcello passone remarque à juste titre qu’après les visions animistes, puis religieuses du monde, qui ont répondu à un questionnement très ancien chez les peuples vivant en bordure de la méditerranée, freud a introduit une vision scientifique du rêve visant à retrouver les représentations et les affects enfouis dans l’inconscient. cependant, riadh ben rejeb rappelle pertinemment que certains rêves peuvent avoir une valeur prédictive, en particulier concernant des maladies organiques inconnues du rêveur.
comme le montrent l’exemple littéraire de gilgamesh ainsi que les cas cliniques actuels présentés par petra palermiti, riadh ben rejeb et abderrahmane si moussi, la fonction onirique n’est pas unique et peut varier selon l’économie psychique du rêveur. selon que le rêve sera garant ou non de la continuité narcissique du sujet, qu’il donnera ou pas la satisfaction auto-érotique d’avoir rêvé, d’être l’auteur de son propre rêve, on aura toute la gamme des rêves : des rêves réussis ayant une valeur de compromis, aux rêves d’angoisse qui se poursuivent durant la pensée diurne, aux cauchemars dont le réveil brutal témoigne d’un triomphe du moi, aux rêves source de terreur comme dans le fonctionnement psychotique, jusqu’à la lutte éperdue pour ne pas rêver et recourir plutôt aux agirs auto ou hétéro-destructeurs.
le rêve s’inscrit dans la dimension générale du fonctionnement psychique, et peut à juste titre donner un indice sur la qualité de ce fonctionnement psychique. c’est à quoi freud a été conduit dans une remise en cause de sa théorie du rêve, comme le souligne bianca lechevalier dans son article à propos de la fonction anti-traumatique du rêve. si la découverte freudienne a été centrée sur l’hypothèse du rêve comme satisfaction hallucinatoire d’un désir infantile, on sait que freud (1920) a été préoccupé par la question des rêves traumatiques, dans lesquels, dit-il « la fonction du rêve… a été ébranlée et déviée de ses visées » (p.283). freud (1932) s’est interrogé sur ces rêves qui supposent davantage « la tentative d’un accomplissement de souhait » (p.111). autrement dit après la découverte de la signification, de la structure et de l’économie du rêve, freud a été conduit à réfléchir sur les conditions préalables à l’instauration du rêve comme accomplissement de désir. entre la réflexion sur le sens du rêve et celle sur les enjeux de la capacité de rêver s’est ouvert un domaine de recherches corrélatif de l’ouverture de la pensée psychanalytique aux organisations non névrotiques.
d’où l’intérêt, après la découverte freudienne d’un travail du rêve et de ses mécanismes, pour l’expérience subjective et intrapsychique du rêveur et sa fonction dans l’expérience intersubjective de la cure, auquel a été conduit freud ultérieurement, ainsi que de nombreux analystes. c’est le cas en particulier de masud r. khan (1975) qui a introduit le concept d’expérience du rêve renvoyant à un monde incommunicable, pourtant agissant dans le sommeil et dans la vie vigile, et différent autant du contenu latent du rêve qui peut être énoncé dans un langage discursif que du vécu du rêve pendant le sommeil. il s’agirait de donner une place au désir du rêveur de retrouver son propre sentiment d’exister.
c’est un enjeu majeur auquel bianca lechevalier accorde une importance majeure, dans son article, aux images du rêve dans leur « complexité polysensorielle mobile » qui serait éventuellement une caractéristique de l’enfance méditerranéenne de notre culture. les fantasmes inconscients qui s’expriment dans les rêves utiliseraient par ailleurs un travail de culture déjà là dans les contes, les récits épiques et mythologiques. freud précise bien à propos des symboles du rêve qu’ils ne sont pas le résultat du travail du rêve mais constituent un déjà là utilisé par le rêveur dans sa visée de déguisement des représentations refoulées.
bianca lechevalier s’attache au corps et à sa symbolisation dans la pensée du rêve et au jeu avec les traces de notre mémoire inscrite dans notre corps, ce qui fait écho à ce que freud (1914) avait souligné de l’importance, à côté de la mémoire diurne du souvenir remémoré, d’une mémoire du rêve renvoyant à ces expériences sensorielles antérieures au langage (a. gibeault, 2020). elle s’interroge à juste titre sur le plaisir du jeu identificatoire des rêves aux contes, aux chants et à la littérature en méditerranée qui ferait une part importante à la sensorialité. c’est aussi l’expérience personnelle de martine myquel qui dans son article, en guise d’épilogue, évoque les sensations de son enfance en algérie lors de son arrivée à kélibia, une « mémoire du corps se ravivant par les perceptions sensorielles, ici l’odorat, mais sans doute lié à d’autres perceptions et entraînant émotions et affects ».
dans son article, sesto marcello passone poursuit cette interrogation sur la spécificité de la psychanalyse en méditerranée qu’il décrit comme un « miroir à rêves » favorisant la créativité « qui consiste à toujours recréer, relier d’une autre manière la relation à ce qui a été expérimenté comme déjà perdu : la relation à l’objet primaire maternant en premier lieu ». c’est une perspective qui rejoint celle de j.-b. pontalis (1972) qui rappelle que le désir de dormir infiltre et explique la visée régressive du rêve : dès lors « rêver, c’est d’abord tenter de maintenir l’impossible union avec la mère, préserver une totalité indivise, se mouvoir dans un espace d’avant le temps » (p. 263). le rêve témoignerait donc de ce retour aux origines, de cette impossible fusion avec la mère en deçà des mots, dans la mesure où le désir de rêver, fonctionnant selon le principe de plaisir, sert à préserver le désir de dormir, selon la visée du principe de nirvana. la faillite de l’expérience du rêve serait dès lors le signe d’un déséquilibre entre le rêve et le sommeil et expliquerait la nostalgie d’une expérience ineffable, voire celle de prédire le futur dans le fantasme d’une coïncidence avec la réalité.
mais si le rêve est par essence maternel, l’interprétation ne peut qu’avoir une fonction paternelle. en tant qu’elle élimine la polyvalence des images du rêve, la parole de l’analyste vient briser le lien imaginaire entre le rêveur et son rêve, et remet en question l’illusion du rêve de pouvoir atteindre ce « lieu mythique », « où rien ne serait disjoint » et « où le réel serait imaginaire et l’imaginaire réel » (pontalis, 1972, p. 271).
quelle réponse apporter alors à la question posée par sesto marcello passone à la fin de son article : « qu’en est-il de notre actuel songe projeté/reflété par ce miroir de mémoires et d’appels qu’est la méditerranée ? ». son titre en contenait un indice : « mare nostrum », à savoir « notre mer », qui suscite plus qu’un autre lieu d’histoire, notre fantasme de retrouvailles avec le narcissisme primaire, avec « notre mère », le paradis perdu de l’enfance. mais freud a bien précisé que c’est moins le rêve qui est la voie royale vers l’inconscient, que l’interprétation des rêves. c’est bien le message de l’epopée de gilgamesh que le rêve exige un interprète pour mieux faire face aux angoisses de tout être humain hanté par l’illusion de l’immortalité et de l’omnipotence et contraint d’accepter la désillusion du « retour à la vie ordinaire ». c’est aussi l’histoire de la méditerranée qui a contraint les navigateurs à surmonter leurs angoisses, à affronter les obstacles de la navigation et à favoriser une vie d’échanges apte à donner de la couleur à la « vie ordinaire ». nous ne pouvons qu’être reconnaissants aux auteurs de ce livre de nous avoir invités et initiés à cette nouvelle aventure de la « psychanalyse en méditerranée » !
bibliographie
- bottéro (j.) (1992), traduction et présentation de l’epopée de gilgamesh. le grand homme qui ne voulait pas mourir. paris, gallimard, 300 p.
- braudel (f.) (1985), la méditerranée. paris, flammarion, 2017, 373 p.
- freud (s.) (1900 1901a), « du rêve », in œuvres complètes. psychanalyse, v, 1901. paris, puf, 2012, pp. 15-71.
- freud (s.) (1919-1920 1920 g), « au-delà du principe de plaisir », in œuvres complètes. psychanalyse, xv, 1916-1920. paris, puf, 1996, pp. 273-338.
- freud (s.) (1925 1925i), « quelques suppléments à l’ensemble de l’interprétation du rêve », in œuvres complètes. psychanalyse, xvii, 1923-1925. paris, puf, 1992, pp.173-188.
- freud (s.) (1932 1933 a), « nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse », in œuvres complètes. psychanalyse, xix, 1931-1936. paris, puf, 1995, pp. 83-268.
- gibeault (a.) (2021), traumatisme et psychose. dans j. angelergues; h. parat et f. cointot (sous la direction de) mémoires : se souvenir, oublier. paris, puf.
- khan masud (r.) (1975), de l’expérience du rêve à la réalité psychique, in nouvelle revue de psychanalyse, n°12 (la psyché), pp.89-99.
- pontalis (j.-b.) (1972), la pénétration du rêve, in nouvelle revue de psychanalyse, n° 5 (l’espace du rêve), pp.257-271.
* - philosophe, psychologue et psychanalyste ; membre titulaire formateur de la société psychanalytique de paris (spp), ancien directeur du centre de psychanalyse et de psychothérapie evelyne et jean kestemberg à paris (asm 13), ancien secrétaire général de l’association psychanalytique internationale (ipa) et ancien président de la fédération européenne de psychanalyse (fep), alain gibeault est également membre du gretorep (groupe de recherche interdisciplinaire réunissant psychanalystes, préhistoriens, anthropologues et historiens de l’art).
il est co-rédacteur en chef avec clarisse baruch de la revue psychanalyse et psychose. il est auteur de nombreuses contributions scientifiques dont :
- les chemins de la symbolisation (paris, puf, 2010).
- reading french psychoanalysis (new york, routledge, 2010) en collaboration avec dana birksted-breen et sara flanders.
- initiating psychoanalysis. perspectives (bernard reith et al. ed.). new york, routledge, 2012.
- l’origine des représentations, regards croisés sur l’art préhistorique (françois sacco et eric robert (ed.). paris, editions ithaque, 2016.
- beginning analysis. on the prcesses of initiating psychoanalysis. (bernard reith et al. ed.), new york, routledge, 2018.