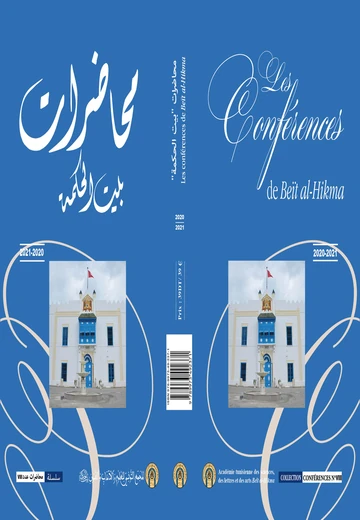Mesdames et messieurs,
chers collègues,
j’ai le grand plaisir d’ouvrir les travaux de votre colloque sur la littérature francophone en tunisie. c’est un sujet qui s’inscrit dans le cadre des activités de notre académie et, en particulier, dans celles du département des lettres ; il traite d’un sujet s’inscrivant dans le cadre de l’année 2021 où se déroulera à djerba, le sommet de la francophonie.
la littérature francophone en tunisie est une réalité, et nous devons tous considérer qu’elle fait partie non seulement de notre patrimoine mais également de notre vécu, puisque des publications ont été réalisées pendant la période du protectorat, et que la production tunisienne littéraire en français continue depuis l’indépendance. donc c’est une réalité que nous assumons et nous avons le devoir de l’évaluer : est- ce qu’elle a pu accéder à l’universalité ? est ce qu’elle a pu s’imposer sur le plan national et sur le plan international ?
j’ai bien apprécié les thèmes qui sont inscrits dans le sous- titre de votre colloque : évolution, renouvellement et devenir. nous devons effectivement poser ces questions en estimant cette littérature, en nous interrogeant sur le profil du lecteur et de l’auteur, sur le but recherché, est-elle destinée à un public restreint ou à un large public ? est ce qu’elle a une aura au-delà de notre pays ?...
ce sont des sujets qui méritent effectivement d’être traités, d’être analysés. il s’agit également de savoir si cette littérature est uniforme ou bien plurielle. est-ce qu’elle traite des sujets particuliers ou englobe-t-elle des sujets qui dépassent le seul intérêt d’une catégorie sociale quelle qu’elle soit. donc, comment ce renouvellement procède t-il, est-ce qu’il se produit au niveau de l’expression de la pensée, est-ce qu’il se produit en symbiose avec la littérature francophone d’une manière générale, est-ce qu’il se fait en rapport avec l’activité culturelle dans notre pays et dans les pays francophones ? ce sont des sujets qui méritent en effet réflexion.
le problème du devenir se pose pour toute la littérature tunisienne qu’elle soit écrite en arabe ou en français.
il y a un siècle et jusqu’à il y a 40 ou 50 ans, la langue française était celle de la diplomatie, des élites et de la production scientifique. lorsqu’on constate aujourd’hui que des congrès se déroulant même en france utilisent uniquement l’anglais, on est en droit de se demander quel est l’avenir de la langue française.
quoi qu’il en soit, en ce qui nous concerne nous avons été, depuis l’indépendance, un pays qui a favorisé l’utilisation du français par rapport à la langue nationale, c’est-à-dire l’arabe. aujourd’hui, il faudrait faire le bilan de ce choix : est ce que nous devons continuer ce bilinguisme arabe – français ? est- ce que nos jeunes, sont encore en mesure de maîtriser les deux langues ? car être bilingue en fait c’est être capable de comprendre et de s’exprimer en arabe et en français. ce sont des questions qui se posent parce que dans les médias et même dans le langage courant, l’utilisation d’un mélange de l’arabe et du français fait que l’emploie du français se rétrécit en quelque sorte, et devient presque une utilisation conjoncturelle en fonction de la participation à des manifestations particulières. ce n’est plus une langue qui est toujours utilisée et dans n’importe quelle situation.
le problème c’est que pour participer à l’évolution de l’humanité d’une manière générale et à l’innovation, nous avons aujourd’hui le devoir de former des étudiants, des élèves, des jeunes plutôt plurilingues et non plus bilingues. le devenir de la langue française est aussi lié à la fonction de sa situation, pas uniquement en tunisie mais aussi dans le monde. aussi étudier la littérature francophone en tunisie est un beau sujet invitant effectivement à la réflexion dans le cadre des thèmes qui vont être abordés dans ce séminaire. je ne peux que féliciter le département des lettres d’avoir songé à soulever ces problèmes et à y penser.
je remercie à cette occasion les collègues du département des lettres, sa directrice madame raja yassine bahri et madame alia baccar bornaz qui a été l’initiatrice en quelque sorte de ce colloque et qui a suivi toutes les étapes de son organisation. je voudrais également remercier l’institut français de tunisie pour la coopération qui s’est établie non seulement à propos de ce colloque mais qui se poursuit depuis des années, et plus précisément depuis les débuts de l’académie tunisienne et on ne peut que s’en féliciter.
donc voilà les quelques mots d’introduction que j’ai voulu apporter à votre colloque et je souhaite plein succès à vos travaux. j’espère qu’ils feront bientôt l’objet de publication parce que dans les conditions actuelles de cette épidémie nous n’avons pas pu inviter un large public pour écouter les communications qui pourront être suivies comme d’habitude sur le site de l’académie: https://www.beitalhikma.tn/ et sur la chaîne youtube. la publication des actes du colloque sera certainement un document qui servira pour tous ceux et celles qui s’intéressent à la littérature et à la culture en général.
merci de votre attention.
abdelmajid charfi
président de l’académie tunisienne
des sciences, des lettres et des arts beït al-hikma présentation
monsieur le président de l’académie, professeur abdelmajid charfi
madame le professeur alia baccar bornaz, organisatrice du colloque,
chers collègues académiciens,
mesdames et messieurs,
chers invités
c’est dans ce majestueux palais chargé d’histoire, beït al-hikma, siège de l’académie, que je vous souhaite la bienvenue.
nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu organiser ce colloque dans des circonstances difficiles dues à la pandémie dont souffre le monde depuis le mois de décembre 2019. nous regrettons le désistement de quelques collègues et amis européens, qui, pour des raisons sanitaires n’ont pu participer à notre rencontre d’aujourd’hui. je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont envoyé leurs communications écrites et qui seront lues par des collègues ici présents à qui vont aussi nos remerciements.
le colloque est organisé par le département des lettres de l’académie beït al-hikma sous la direction du professeur alia baccar bornaz avec la participation de cinq de ses membres. comme vous le savez, le département des lettres est pluridisciplinaire puisqu’il regroupe plusieurs langues, à savoir les lettres arabe, française, anglaise, germanique et espagnole. il est composé de 17 membres actifs et de quatre membres correspondants de nationalités différentes.
cette manifestation littéraire nous donnera l’occasion de parler de la francophonie et de l’importance de la langue française en tunisie, considérée depuis l’indépendance comme la deuxième langue officielle du pays. il est à rappeler que la langue française a toujours existé après l’arabe et le turc et ce, depuis le xixe siècle et a été parlée en particulier par l’élite tunisienne.
de tous temps, la france a entretenu des liens historiques avec la tunisie non seulement à cause de la proximité géographique mais aussi pour des raisons, économiques, sociales, culturelles et politiques. je me permets d’évoquer un détail que j’ai découvert dans la bibliothèque de mon père dans un livre dédicacé par l’auteur paul marty et intitulé histoire de la mission militaire française en tunisie (1827-1882). dans cette revue on apprend que de 1827 à 1882, des officiers et des missions militaires françaises ont contribué à l’instruction des troupes beylicales avec la création au bardo de l’ecole des sous-officiers sur instruction du bey hussein et de ses successeurs. dès lors, des officiers français ont été engagés comme instructeurs par des contrats privés.
suite à l’instauration du protectorat, la langue française s’est répandue dans le pays grâce à la création d’écoles, imprégnant très tôt l’élite tunisienne par cette langue et cette culture.
ce colloque intitulé, la littérature francophone en tunisie : evolution, renouvellement et devenir, nous donnera l’occasion de parler de ce genre littéraire, de rencontrer des écrivains et écrivaines d’expression française et d’échanger des points de vue différents. comme l’indique le programme, il se déroulera sur une journée et demie. une table ronde est prévue cette après-midi à partir de 14h et à laquelle participeront les écrivains et écrivaines d’expression française : ali abassi - anouar attia -hélé béji- emna bel haj yahia - ilham ben miled - alfonso campisi-- - salah el gharbi -ahmed mahfoudh -wafa bsaïs ouari - mokhtar sahnoun- huguette senia-badeau.
les actes du colloque seront édités par le service des publications de l’académie en collaboration avec l’institut français de la coopération en tunisie que je remercie pour leur soutien.
je saisis aussi cette occasion pour vous rappeler de bien vouloir envoyer vos textes au professeur alia baccar bornaz, responsable du colloque, dans les meilleurs délais qui vous seront indiqués.
je lui cède donc la parole pour d’autres éclaircissements et pour nous présenter un panorama de la littérature francophone en tunisie.
raja yassine bahri
directrice du département des lettres mot de bienvenue
permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue en ces journées de pandémie qui ont conditionné notre rencontre.
a dire vrai, elle devait avoir lieu dans le cadre du sommet de la francophonie en décembre 2020. mais celui-ci ayant été reporté à novembre 2021 et déplacé à djerba, le comité d’organisation a préféré la maintenir aux mêmes dates.
evidemment, il a fallu sacrifier la participation de nos collègues de l’étranger qui, en se déplaçant, devaient subir deux confinements de part et d’autre de la méditerranée. quelques-uns d’entre eux ont tenu à envoyer leur texte par mail et je les en remercie.
il a fallu aussi respecter les conditions sanitaires imposées par la covid-19 en réduisant le nombre du public et des participants.
bref, nous sommes là et nous vous remercions de vous être déplacé en ces temps difficiles.
cette assemblée n’aurait pu se concrétiser sans le soutien éclairé du président de l’académie le pr abdelmajid charfi et de la directrice du département des lettres mme raja yassine bahri qui m’ont soutenue pour la réalisation de ce colloque et pour dépasser de multiples épreuves. qu’ils reçoivent aujourd’hui l’expression de ma reconnaissance.
je voudrais aussi remercier les services de l’institut culturel français de tunisie, représentés ce matin par messieurs christophe clanché et pierre durand de ramefort, attachés de coopération scientifique et universitaire à l’ift, pour leur contribution à la prise en charge d’une partie des frais de publication des actes qui verront le jour dans les meilleurs délais, si vous nous remettez vos textes au plus tôt.
merci aux participants d’avoir relevé le défi en ces jours incertains et d’être avec nous aujourd’hui.
alia baccar bornaz
membre actif de l’académie