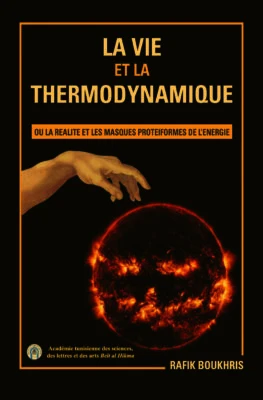Introduction
« le plus noble des plaisirs est la joie de comprendre »
(léonard de vinci)
vivre, ce n’est certainement pas se contenter d’une vie biologique, animale, mais c’est surtout essayer de comprendre le fil conducteur qui existerait derrière l’existence de l’univers où nous nous trouvons, de ses structures les plus grandes jusqu’au mystère des particules subatomiques et des quarks, et bien sûr aussi au mystère de la vie qui nous anime. schopenhauer a porté un jugement sévère sur ceux qui naissent puis meurent sans avoir réfléchi ni à ce qui les entoure, ni à ce qu’ils sont : « ceux qui ne se posent pas de question sur leur existence et celle de l’univers sont mentalement déficients ».
l’objectif majeur de la philosophie et de la science est de comprendre, surtout comprendre. leur but majeur est d’essayer de percer la nature et les lois physiques d’un univers apparemment inconscient, ainsi que la nature et les lois biologiques du vivant, ces objectifs étant complétés par une approche épistémologique de la connaissance et de l’extension de cette dernière à la possibilité (ou non) de parvenir à connaitre la réalité de ce qui nous entoure.
des savants et philosophes ont posé de façon élégante le dilemme des humains dans leur quête du savoir. les upanishads de l’inde, les penseurs de l’antiquité akkadienne, cananéenne et égyptienne, mais surtout les philosophes de la grèce ont réfléchi au lien intime qui existe entre le savoir et la philosophie. chez les grecs, probablement inspirés par leurs contacts avec les anciens égyptiens et irakiens, on retrouve la célèbre métaphore du mythe de prométhée dans lequel ce dernier se rebelle contre les dieux pour apporter le savoir (symbolisé par le feu sacré de l’olympe) aux humains.
le mathématicien et philosophe hellène, archytas (428-347 aec), est le fondateur de l’ingénierie mécanique et le créateur du premier robot (un pigeon volant). il a bien exposé le lien entre science et philosophie en écrivant : « on peut dire que la philosophie est le désir de savoir et de comprendre les choses elles-mêmes… le commencement de la philosophie est la science de la nature… la science elle-même ».
on retrouve aussi l’importance donnée au savoir dans l’odyssée d’homère comme l’a montré cicéron. en revoyant dans le texte d’homère la description de l’extraordinaire attraction exercée par le chant des sirènes sur les marins, cicéron lui donne une autre interprétation. les vers d’homère, chantés par les sirènes sur leur rocher, promettent au marin qu’après son séjour chez elles : « il va repartir vers les rivages de sa patrie avec beaucoup plus de sagesse… et avec les secrets de toutes les choses existant sur cette terre ».
cicéron a fait ensuite le commentaire suivant sur le texte d’homère (traduit et cité in quintus, 25-10-2018) : « les sirènes promettent le savoir ; et il n’est pas étonnant que cela soit plus précieux pour celui qui aime la sagesse que sa propre patrie. vouloir connaître tout ce qui est sous le soleil, sans donner d’importance aux limites, est vouloir être compté parmi les curieux ; mais être guidé par de grandes idées vers le sincère amour du savoir doit être considéré comme étant une caractéristique des plus grands parmi les hommes » (cicéron, de finibus bonorum et malorum).
un autre romain, lucrèce, a écrit à ce propos dans son de rerum natura (1-146) : « ces terreurs, ces ténèbres de l’âme, il faut les dissiper. le soleil ni l’éclat du jour ne les transperceront, mais par contre la vue et l’explication de la nature. son principe le voici ; il nous servira d’exorde. rien ne naît de rien, divinement. si la peur accable ainsi tous les mortels, c’est qu’ils observent sur la terre et dans le ciel mille phénomènes dont les causes leur sont cachées…dès que nous aurons vu que rien ne peut surgir de rien, nous percevrons mieux l’objet de notre quête ».
plus près de notre époque, albert camus s’était posé aussi une question fondamentale à propos de comprendre la vie et si cette dernière mérite d’être vécue : « il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie ». mais sa réponse à sa propre question n’est pas moins fondamentale : « si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. la bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. on ne peut pas avoir froid sans cesse ». et la voie de la vie vers le soleil se résume en trois verbes : comprendre, aimer, survivre.
le grand savant anglais de cambridge stephen hawking a souvent évoqué la soif des humains à vivre et à comprendre : « nous aspirons encore à savoir pourquoi nous sommes ici et d’où nous venons ; le profond désir de savoir de l’humanité est assez de justification pour notre quête continue. et notre but n’est rien de moins qu’une description complète de l’univers où nous vivons » (157). et son compatriote d’oxford, richard dawkins, a lui aussi joliment résumé l’importance du savoir, de ‘comprendre’ : « après avoir dormi pendant des centaines de millions de siècles, nous avons finalement ouvert nos yeux sur une planète somptueuse, scintillante de couleur, abondante de vie. au bout de quelques décennies, nous devons fermer nos yeux de nouveau. est-ce que ce n’est pas une façon noble, et éclairée, que de passer notre court temps au soleil, à essayer de comprendre l’univers, et comment il nous est arrivé de nous réveiller en son sein » (80).
les neurosciences sont un outil important pour nous aider à progresser dans cette entreprise car elles sont aujourd’hui en partie la continuation de la philosophie d’hier et un outil majeur, rationnel et performant pour nous guider dans la compréhension du monde, de la vie, de l’existence, de la conscience, etc. les neurosciences sont la branche scientifique qui permet de réunir ensemble les observations de la science et les intuitions de la philosophie, sans être le prisonnier des formes simplement mécanistiques de la première et des errements parfois irrationnels de la seconde (312, 347, 349).
il faut aussi beaucoup de modestie pour progresser dans cette quête. il est vrai que chacun d’entre nous est réellement unique puisqu’on a estimé qu’il a fallu (statistiquement) réunir un concours de hasards extraordinaires pour qu’une personne puisse naître et être ce qu’elle est : une chance sur quatre cent mille milliards. on peut donc considérer que chaque personne est unique car, pour qu’il ait existé dans le passé ou pour qu’il puisse exister dans le futur quelqu’un de semblable, relève quasiment du domaine de l’impossible.
mais il est vrai aussi qu’il ne faut pas commettre l’erreur de croire que les humains sont le but et la raison de l’existence de l’univers : « la vie, notre vie, est apparue sur une planète tournant autour d’une étoile perdue (avec des milliards d’autres) excentriquement sur un des bras de la spirale d’une galaxie, perdue elle aussi au milieu de milliards d’autres galaxies » (39). et sur notre petite planète, nous ne sommes qu’une des 10 millions d’espèces vivantes aujourd’hui et une de l’ensemble du milliard d’espèces qui y ont vécu à un moment ou un autre.
dans nos tentatives de comprendre, il faut surtout beaucoup de modestie pour se débarrasser du très lourd fardeau de l’anthropocentrisme et ne pas considérer les humains comme l’objet central de l’univers. l’intelligence biologique a réalisé chez le vivant de nombreuses autres prouesses que nous n’arrivons même pas à comprendre encore et plusieurs chercheurs nous recommandent de ne pas être prétentieux. l.l. monoz a écrit : « il y a plus d’une façon de faire un neurone, et plus d’une façon de faire un cerveau » (230) et alan watts s’adresse tout particulièrement aux penseurs occidentaux : « a cause d’un conditionnement culturel et social, (le scientifique occidental) a été hypnotisé pour s’expérimenter soi-même comme un ego – comme un centre isolé de conscience et de volonté à l’intérieur d’un sac de peau, en confrontation avec un monde externe et étranger. nous disons « nous sommes venus au monde » mais nous n’avons rien fait de cela. nous sommes sortis de lui de la même façon qu’un fruit sort des arbres » (334).
les premiers humains, leurs religions et presque tous leurs penseurs et philosophes étaient persuadés de la centralité des humains et de leur planète dans l’univers. ils pensaient que la terre est fixe, au centre de l’univers et que tout tourne autour d’elle. cette notion a été fermement ancrée dans les conceptions des anciens par ptolémée (90-168) grâce à son ouvrage hé megalé syntaxis, fortement admiré ensuite par tous les savants arabo-musulmans sous le nom d’almageste.
mais déjà des siècles avant ptolémée, certains savants grecs (dont surtout aristarque de samos : 310-230 aec) avaient rejeté la notion du géocentrisme de la terre. il faudra cependant attendre les 16-17ème siècles pour que copernic (1473-1543) vienne détrôner la terre de son rôle de centre de l’univers pour lui donner sa véritable et très périphérique position. kepler (1571-1630) et galilée (1564-1642) finiront par établir définitivement la révolution copernicienne.
les progrès scientifiques ont toujours été accompagnés (depuis l’antiquité) par une réaction violente de la part des hommes de religion, de toutes les religions. hypatie en egypte en est un exemple célèbre. plus près de nous, etienne dolet est étranglé et brûlé avec ses livres sur la place maubert le 3 août 1546. cette même année et sur la même place maubert, trois autres imprimeurs sont brûlés. sept ans plus tard, le 27 octobre 1553, michel servet est condamné à genève dans ces termes : « toy, michel servet, condamnons à debvoir estre lié et mené au lieu de champel ; et là debvoir estre à un piloris attaché et bruslé tout vifz avec ton livre… jusques à ce que ton corps soit réduit en cendres ; et ainsi finiras tes jours pour donner exemple aux autres qui tel cas vouldroient commettre ».
la violence religieuse ne s’arrêtera pas là. le 17 février 1600, le mathématicien et philosophe italien giordano bruno est pendu, nu et la tête en bas, puis brûlé sur le bûcher. le 1er juillet 1766, le chevalier de la barre est torturé, décapité puis brûlé à l’âge de 19 ans, « pour n’avoir pas salué une procession ». mais la vraie raison était tout autre car on lui avait cloué sur le torse le dictionnaire philosophique de voltaire.
parce que leurs idées n’étaient pas pour plaire à l’église catholique, bien d’autres savants furent assassinés de la même façon pour supprimer la libre-pensée et les progrès de la science, alors que d’autres nient leurs idées (dont galilée en 1633) ou s’enfuyaient (dont voltaire). quelques siècles auparavant et dans le monde arabo-musulman, les philosophes et les savants avaient connu les mêmes exactions : cachots, tortures, étranglements, décapitations, bûchers, exils, livres brûlés, etc.
cependant les progrès scientifiques ont continué et on réalisa que non seulement la terre n’est certainement pas le centre de l’univers, mais de nombreuses autres fausses notions scientifiques sorties des cosmogonies religieuses furent rejetées pour toujours. darwin détruisit un grand pan du prétentieux anthropocentrisme en montrant que les humains ne sont qu’un chaînon dans une longue évolution animale. les choses se précisent encore plus quand les biologistes moléculaires montrèrent que toutes les cellules animales (y compris les nôtres) ne sont qu’un cocktail de plusieurs éléments constitutifs dont d’anciennes bactéries qui y vivent en symbioses. ainsi par exemple, selon la théorie de l’endosymbiose, des bactéries, α-protéobactéries et cyanobactéries photosynthétiques, phagocytées (pour leur valeur nutritive) par les cellules eucaryotes primitives, ont pu développer une association symbiotique avec leurs cellules eucaryotes hôtes. les α-protéobactéries ont évolué pour donner les mitochondries alors que les cyanobactéries sont devenues les chloroplastes (39).
en 1923, edwin p. hubble a démystifié encore plus notre centralité en montrant que même notre galaxie n’est qu’une galaxie modeste parmi d’innombrables autres galaxies. et enfin en 1929, on se rend compte que l’univers n’est pas la belle mécanique statique et stable qu’on croyait mais qu’il est dans une extraordinaire et de plus en plus rapide expansion.
il va être bien plus dur de mettre fin à la croyance des humains de considérer que l’univers a été conçu pour eux et qu’ils sont sa finalité. ce combat fait encore rage aujourd’hui entre créationnistes et réductionnistes-physicalistes. mais comme la révolution copernicienne a mis fin au géocentrisme de la terre, la grande révolution darwinienne est venue faire reculer l’anthropocentrisme des humains jusqu’à ses derniers retranchements (77, 78). sur un autre plan et malgré l’acceptation de la notion du big bang (unique ou cyclique) par la majorité des scientifiques, certains partisans du créationnisme la refusent ou posent la question encore non résolue de l’avant le big bang. tout en sachant comme l’a dit richard feynman qu’ il est impossible de trouver une réponse à une question qui ne se révélera pas être fausse un jour ».
l’opinion cartésienne (spiritualiste et narcissiste) affirmant qu’il existe une ‘exception humaine’ et que l’homme est totalement séparé du monde physique et animal, situé au-dessus de tout ce qui existe, est de plus en plus battue en brèche par les données scientifiques. la séparation entre les humains et les autres primates est bien moins tranchée qu’on ne le supposait. beaucoup de caractéristiques dites ‘humaines’ se voient à l’état rudimentaire ou même relativement développé chez certains animaux et leur niveau devient de plus en plus important (en parallèle) avec le développement de leur cerveau.
il n’y a pas, comme on le pensait jusqu’à très récemment, une barrière irréductible entre animaux et humains mais au contraire une continuité évidente sur beaucoup de plans : la différence est une question de degré et non pas d’essence (39). en fait, chez de nombreux animaux, l’évolution a choisi des solutions souvent plus brillantes que celles chez les humains, dans tous les secteurs de la biologie, de l’anatomie ou de la physiologie. l’ancêtre du poulpe (un invertébré) par exemple s’est détaché de l’ancêtre qui a mené aux humains il y a plus de 500 millions d’années. cet animal a trois cœurs, un sang bleu et une rétine meilleure que la nôtre car il n’a pas de tache aveugle. il est d’une intelligence rare dans le monde animal et on vient de se rendre compte que son système nerveux est très particulier, car en plus d’un cerveau central (contenant le 1/3 de ses neurones), les nerfs de ses huit bras se centralisent dans ses huit petits cerveaux périphériques (avec les 2/3 de ses neurones). ces derniers sont responsables des capacités extraordinaires de perception, de sensibilité et de motricité des huit bras du poulpe et même de leur relative autonomie (149).
revoyant les nombreuses données scientifiques disponibles, jean-marie schaeffer a conclu dans son ouvrage ‘la fin de l’exception humaine’ que l’éthologie (étude du comportement des animaux dans la nature) montre qu’il n’existe pas de coupure ontique entre l’homme et le monde dit ‘animal’, qu’il n’y a pas d’opposition véritable entre nature et culture, et que les phénomènes humains et animaux peuvent être, de la même façon, naturels et culturels (293).
si la biologie, dans ses résultats les plus pointus, révèle que l’humain n’est, biologiquement, pas très différent de beaucoup d’autres êtres vivants, il en est un peu de même en ce qui concerne la culture. on pourrait définir la culture d’une population donnée comme étant l’existence et la transmission d’un ensemble d’habitudes, de connaissances, de techniques mais aussi d’une échelle de valeurs et de règlements sociaux. or l’éthologie a montré qu’un embryon de vie sociale et culturelle existe aussi dans le monde animal. même la ‘culture par accumulation’ qui paraissait une acquisition relativement récente chez les humains (et probablement liée à l’acquisition du langage) existerait à l’état d’ébauche chez les chimpanzés par exemple. on sait maintenant que ces derniers peuvent prévoir, anticiper, s’organiser, inventer, et exploiter les expériences passées pour mieux faire à l’avenir. on a observé des dizaines de comportements acquis chez des groupes de chimpanzés qui étaient inconnus chez d’autres groupes. des innovations faites par un membre d’un groupe de chimpanzés ont été transmises, par imitation et apprentissage, non seulement aux autres membres du groupe, mais aux générations suivantes. une génération profite donc des acquis de la ‘culture’ des précédentes, exactement comme chez les humains.
des primates sont capables de concevoir le futur immédiat et ont non seulement une ‘conscience de soi’, mais aussi une ‘conscience des états mentaux’ des autres. ils ont comme nous des règles sociales et affectives, des sentiments de joie ou de peine, et ils se rendent compte même de la notion que des actions sont ‘bonnes ou mauvaises’. ils sont capables de rouerie mais aussi d’altruisme et sont certainement capables de s’adapter à des changements du milieu.
nous ne sommes pas apparus ‘intelligents’ sur la scène terrestre. il est certain que l’intelligence chez les humains et leurs ancêtres ne s’est pas développée d’un coup, par ‘miracle’. c’est par une lente accumulation culturelle sur des millions d’années que notre néocortex s’est développé au-dessus de nos anciens cerveaux plus primitifs. la lente augmentation des mensurations de la boîte crânienne est là pour en témoigner (39).
acceptons-le une fois pour toutes : la voie qui a mené à notre ‘intelligence humaine’ a été une course d’obstacles très dure et très longue. il a fallu certainement beaucoup de hasard pour que la première combinaison gagnante, celle des conditions nécessaires au démarrage des premières cellules vivantes, se soit produite à un moment donné. nos ancêtres, des animaux simples, ont existé des milliards d’années avant l’apparition de nos ancêtres les plus récents, australopithèques et premiers homo, et ils ont tous fait face à d’innombrables écueils qui auraient pu annihiler les lignées qui ont mené jusqu’à nous.
il a fallu parcourir une longue et très dangereuse course d’obstacles parsemée d’embûches mortelles pour arriver aux humains et cela pourrait n’être qu’un coup de chance inouï et unique survenu sur la terre : « (la matière inerte) ne sera plus, sur la terre, génitrice de matière vivante… les conditions d’avant n’en permettaient pas l’émergence, et celles d’après ne le permettaient plus » (66).
jacques monod (nobel de médecine 1965) a émis une opinion proche de celle de coppens. il a souligné dans son livre le hasard et la nécessité que, dans la mesure où l’univers ne porte pas en lui la vie et la biosphère ne porte pas en elle l’humain, le destin des humains n’a pas été écrit avant eux mais s’écrit au même moment que l’événement et non pas avant lui : « l’ancienne alliance est rompue : l’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’univers d’où il a émergé par hasard. non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. a lui de choisir entre le royaume et les ténèbres » (229).
monod a aussi écrit que ‘notre numéro est sorti à la roulette de monte-carlo !’ par deux coups de chance successifs…’un hasard au carré’. on pourrait même dire que pour que la vie soit apparue sur la terre et se soit développée pour arriver jusqu’aux humains, il a fallu que notre numéro sorte ‘à la roulette de monte-carlo plus d’une dizaine de fois’. un seul obstacle non franchi aurait été la fin du parcours et homo sapiens n’aurait jamais existé. notre existence est précieuse parce qu’il a fallu énormément de chance pour que se produise la coalescence d’atomes qui a fait démarrer la vie et nous a fait arriver à la conscience, et donc à la philosophie et à la musique.
s’agissant de l’apparition de la vie sur la terre, les créationnistes disent qu’il n’est pas possible que le vivant ait une origine purement physico-chimique. il est vrai que la connaissance de la piste biochimique qui a permis le passage de la non-vie à la vie, à cette extraordinaire machine récursive de polypeptides et nucléotides, est encore ardue. mais : « les calculs standard de l’improbabilité pour que les structures auto-catalytiques de la complexité de la vie soient le résultat du hasard sont basés sur des assomptions d’un état d’équilibre. et la terre, une région d’énergie organisée, n’est pas maintenant, et n’a jamais été, en équilibre. sur elle, certains arrangements, compositions, et combinaisons sont bien plus possibles que d’autres » (295). et les progrès déjà accomplis dans plusieurs domaines sont impressionnants.
les découvertes sur la progression de l’intelligence biologique jusqu’aux humains sont nombreuses et importantes. lorsque des chercheurs de l’université de californie ont étudié les changements du code génétique humain par rapport à ceux de la souris, du rat et du chimpanzé, ils ont localisé 49 sections d’adn intéressantes. lors des derniers millions d’années, ces sections sont restées pratiquement stables chez la souris, le rat et le chimpanzé. elles ont par contre beaucoup changé chez les humains.
ces portions d’adn (appelées har pour human accelerated region) comprennent la har1 qui a un code génétique de 118 lettres. les har1 du poulet et du chimpanzé (pourtant très distants génétiquement l’un de l’autre) ne diffèrent que de deux lettres. par contre les har1 des humains et des chimpanzés (qui ne se sont séparés qu’il y a environ 5 à 7 millions d’années) ont vu 18 lettres changer dans le code génétique humain (258). le gène har1 f en particulier joue un rôle important dans le développement du cerveau car il contrôle la production de reeline, une protéine qui, organisant les différentes couches du cerveau, serait responsable du développement plus rapide du cerveau humain par rapport à celui du chimpanzé.
cependant nous sommes aussi physiquement et biologiquement restés très proches des autres primates, notre ancêtre commun ayant vécu qu’il n’y a quelques millions d’années. même mentalement, ils nous ressemblent beaucoup car ils peuvent anticiper, prévoir, apprendre, transmettre, et ont même augmenté la taille de leur néocortex. mais ils ne l’ont pas fait assez pour pouvoir décoller. ce splendide et douloureux décollage n’a été réalisé que par les humains, les seuls à être conscients de l’univers, d’eux-mêmes dans l’univers, et des terribles interrogations qui en découlent. il faut néanmoins utiliser ce don extraordinaire qu’est notre cerveau à bon escient. cicéron (dans sa de natura deorum) reprochait déjà les abus que le cerveau peut commettre et il ne connaissait pas les terribles crimes qui vont être commis après son époque : « sic vestra ista providentia reprehendenda, quae rationem dederit iis quos scierit ea perverse et improbe usuros» (s’il est une providence, elle est blâmable d’avoir donné aux hommes une intelligence dont elle savait qu’ils devaient abuser).