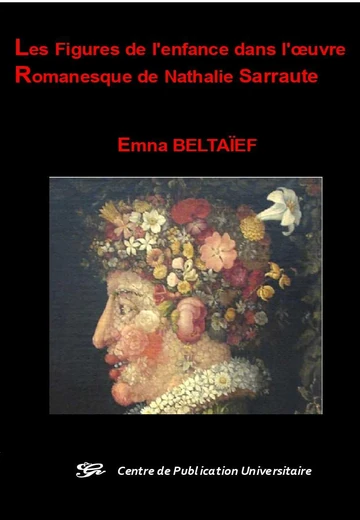C’est en lisant enfance que nous avons fait connaissance avec nathalie sarraute. aussi, est-ce en nous interrogeant sur le rôle de l’enfance dans l’oeuvre de l’écrivain que nous nous sommes intéressé à l’écriture des tropismes. par la suite, afin de nous familiariser avec la pensée de l’auteur, nous avons lu l’ère du soupçon, essai qui contribua à la diffusion des principes de ce que l’on a appelé le « nouveau roman ». dans ce manifeste théorique caractérisé en apparence par un langage neutre, apparaît à maintes reprises le motif de l’enfance. plus précisément, l’ère du soupçon commence et s’achève par des allusions à l’enfance, puisque nous apprenons, d’une part, que les tropismes, mouvements pré-linguistiques aux limites de notre conscience, sont des impressions ressenties depuis l’enfance1, et d’autre part, que les écrivains qui seront capables de révolutionner le roman, sont des individus « morbidement accrochés à leur enfance2 ». l’écrivain y compare en outre les personnages romanesques, types littéraires qu’il remet en question, à de « belles poupées, destinées à amuser les enfants3 ». de la même façon, évoquant la problématique du narrateur omniscient, nathalie sarraute établit une analogie entre le lecteur et l’enfant afin de souligner l’invraisemblance du récit à la troisième personne : aussi, dès que le romancier essaie de décrire les personnages sans révéler sa présence, il lui semble aussitôt entendre le lecteur, pareil à cet enfant à qui sa mère lisait pour la première fois une histoire, l’arrêter en demandant : « qui dit ça ? ». 4 par ailleurs, se démarquant de la philosophie de « l’homo absurdus » véhiculée par l’étranger d’albert camus, nathalie sarraute assimile l’attitude de meursault au « négativisme têtu d’un enfant boudeur », image qui traduit sa méfiance à l’égard d’une vision désespérée del’homme. enfin, pour dénoncer une illusion romanesque qui repose sur des personnages incapables d’éprouver la moindre émotion, entièrement dépourvus d’états psychologiques, elle insiste sur l’absence de « la moindre bribe de souvenir se rattachant à des impressions d’enfance ...1». de fait, la lecture de l’ère du soupçon nous amenait à formuler l’hypothèse de travail suivante : non seulement l’oeuvre de nathalie sarraute semble indissociable de la thématique de l’enfance, mais il est probable que l’écriture sarrautienne est déterminée par une série d’images s’appuyant tantôt sur le personnage de l’enfant en vue de signifier le mépris de l’écrivain vis-à-vis des personnages et narrateurs romanesques, tantôt sur d’autres « figures de l’enfance », en vue d’illustrer sa quête des profondeurs psychologiques. restait donc désormais à appliquer cette hypothèse aux écrits romanesques de nathalie sarraute. pour ce faire, il nous a semblé approprié d’employer l’expression « figures de l’enfance » qui permet d’englober les multiples aspects que revêt l’enfance dans l’oeuvre romanesque de nathalie sarraute. en effet, par sa polysémie, le mot «figure » paraît rendre compte de la pluralité des représentations de l’enfance dans les textes sarrautiens, qu’il s’agisse de la peinture du personnage de l’enfant ou de la description de l’attitude puérile des personnages adultes, qu’il s’agisse des souvenirs d’enfance des personnages romanesques ou de l’imaginaire féérique des narrateurs. d’un autre côté, en désignant les différents procédés stylistiques traitant de l’enfance, tels les clichés langagiers fondés sur le mot « enfant » ou des images plus intimes qui nous situent au sein de l’univers tropismique, le mot « figure » nous invite non seulement à étudier le rapport qui existe entre l’enfance et le sens d’une oeuvre mais, encore, à cerner le style d’un écrivai