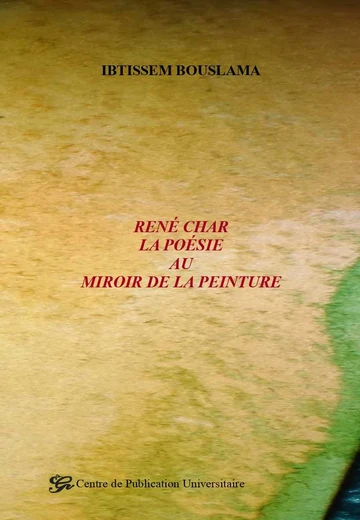Le questionnement des arts plastiques et de la peinture en particulier par la littérature, remonte au moyen âge. mais ce sont sa réactivation et sa problématisation qui ont connu un regain particulier dans les temps modernes. les valeurs de l’ut pictura poesis que nous devons à horace ont ouvert la voie à une pratique littéraire tournée vers les arts, mais l’affranchissement proposé par lessing dans son laocoon des limites imposées par horace, a alimenté les multiples sentiers contemporains de l’approche des arts par la littérature. le dialogue de la littérature et en particulier de la poésie avec ce qu’on appelle les arts visuels, n’a cessé de nourrir les différentes productions dans un champ ou dans l’autre. baudelaire pour ne citer que lui, et avec une extraordinaire clairvoyance, rendait hommage et célébrait par exemple dans les phares l’ascendant des peintres sur son art poétique, et nous connaissons la fortune ultérieure de sa pratique des correspondances et des synesthésies. dans le poème « le désir de peindre » des petits poèmes en prose, il exprimait cette fascination pour la création artistique en écrivant : « malheureux peut être l’homme, mais heureux l’artiste que le désir déchire !1 » la poésie et la peinture au miroir le désir de l’art se matérialisant par l’écriture sur l’art et les artistes, a amené de nombreux poètes du xxe vers les rivages et les lieux de la peinture et de la sculpture pour y inaugurer un nouvel espace de communication et y investir de nouvelles forces créatrices. cette traversée des frontières peut se lire en somme comme une sorte de traversée de miroir. mais dans quelle mesure la poésie peut-elle selire au miroir de la peinture ? et comment cette dénomination peutelle se justifier ? sous cette interrogation, se tient en réalité la problématique de la spécularité qui engage une réflexion sur le métatextuel et le métapictural la spécularité est en effet commune à la littérature et à la peinture, à propos desquelles on peut parler de métatextualité et de métapicturalité. les significations en sont sans doute bien différentes selon les époques et les artistes. elles oscillent toujours entre ces deux extrêmes que sont la célébration et la déconstruction ….2 se penchant sur les oeuvres des peintres qui sont pour la majorité d’entre eux ses contemporains et en les célébrant, rené char s’engage dans une démarche créative d’autoréflexivité sur son oeuvre poétique. en est témoin sa collaboration en 1947 à la revue les miroirs profonds dont le nom dévoile cette mise au miroir de la poésie et de la peinture, mise en regard confirmée par l’un des aphorismes du poète qui y est inséré, et qui invite à enrichir la vue par la multiplication des sources: « l’homme qui ne voit qu’une source ne connaît qu’un orage. les chances en lui sont contrariées3. » la pluralité métaphorique de la source suggérée par l’aphorisme de char dans ce contexte précis des miroirs profonds, rejoint la multiplicité de la vision générée par le miroir telle qu’elle est soulignée par merleau-ponty : le miroir apparaît parce que je suis voyant-visible, parce qu’il y a une réflexivité du sensible, il la traduit et la redouble … il est l’instrument d’une universelle magie qui change les choses en spectacles, les spectacles en choses, moi en autrui et autrui en moi ainsi, la poésie et la peinture sont-elles réunies dans le même espace spéculaire qui autorise de ce fait la mise en rapports et l’interaction des faits propres à chaque champ disciplinaire : notre comparaison du langage et de la peinture n’est possible que grâce à une idée de l’expression créatrice qui est moderne, et pendant des siècles les peintres et les écrivains ont travaillé sans soupçonner leur parenté. mais c’est un fait, comme l’a montré andré malraux que, chacun à leur façon et chacun pour leur compte, ils ont connu la même aventure.5 la mise en mots de la visibilité du langage plastique est une aventure dont le moteur est sans doute, la recherche d’une synesthésie inédite entre l’image à lire et l’image à voir. les mots dans la peinture l’immersion de la poésie en peinture et l’insertion de la figure dans la lettre, ont donné naissance à des modalités de création diverses, et ont par conséquent complexifié la question de l’écrit sur l’art tout en le dotant d’une tonicité singulière. s’interrogeant sur la problématique générique et plus précisément sur la désignation « écrit sur l’art » et ce à quoi elle renvoie, dominique vaugeois affirme : l’écrit sur l’art ne désignerait ainsi pas seulement, de manière tautologique, l’ensemble des textes qui sont sur l’art, mais l’ensemble des textes qui, par leur existence même, interrogent la relation de l’écriture et de l’oeuvre d’art, sous quelque forme que ce soit.du fait de l’appartenance du scriptural et du pictural à deux régimes sémiotiques différents, il est légitime de s’interroger après butor et ponge entre autres s’il y a des mots pour la peinture ? mais d’abord qu’en est-il du regard qui prend en charge la liaison entre le visible et le lisible ? dans l’oeil et l’esprit, merleau-ponty aborde la problématique de la perception en mettant premièrement l’accent sur l’importance de la « visibilité » de la peinture : dans quelque civilisation qu’elle naisse, de quelques croyances, et quelques motifs, de quelques pensées, de quelques cérémonies qu’elle s’entoure, et lors même qu’elle paraît vouée à autre chose, depuis lascaux jusqu’aujourd’hui, pure ou impure, figurative ou non, la peinture ne célèbre jamais d’autre énigme que celle de la visibilité.7 aussi la visibilité des arts plastiques est-elle une donnée fondamentale de son accessibilité immédiate au regard et comme la condition même de son existence. en fait, la motivation qui régit la quête du visible par l’écriture poétique tient dans une recherche, consciente ou inconsciente, d’une forme de complétude entre voir et lire. le dialogue qui s’établit vise ainsi non à combler un vide, mais à gratifier un espace de présence partagée que l’écriture sur l’art des écrivains et des poètes, a tenté d’habiter et d’investir pour en faire un lieu de rencontres singulières. l’objectif du présent travail est de tenter de mettre en évidence la diversité des modalités d’accueil de la peinture par la poésie charienne, et d’analyser la spécificité de ce partage et de cet élan vers et dans l’art. dans ce sens, il nous paraît opportun, dans le cadre de la mise en situation générale lors de la première partie de cette recherche, de mettre en exergue dans le premier chapitre la problématique de l’interaction de la poésie avec la peinture, en étudiant par exemple les formes de dialogue que le poète a mis en scène avec ses amis peintres. le deuxième chapitre aura pour objet d’éclairer l’influence du surréalisme dans l’écriture de la peinture chez char. alors que le troisième chapitre nous permettra d’analyser les diverses configurations et confluences entre poésie et peinture en mettant l’accent particulièrement sur la mise en perspective d’un lyrisme gestuel qui identifie le double geste d’écrire et de peindre. la deuxième partie sera consacrée aux peintres georges braque et nicolas de staël en tant qu’« alliés substantiels » de char. ce qui nous permettra d’étudier les poèmes et les écrits qui leur sont dédiés, et de voir comment la poésie investit l’espace de la peinture pour mettre en vue des territoires communs au poète et aux peintres, poésie qui se distingue par une vision qui infléchit l’art en éthique. dans une perspective plus élargie par l’étude de tout un ensemble de poèmes, la troisième partie mettra en relief la présence d’un peintre auquel char a consacré son avant-dernier dernier recueil paru en 1985 : les voisinages de van gogh. en nouant ce dernier dialogue avec un peintre disparu, le poète consacre ainsi van gogh dans son statut de peintre « ascendant » et de figure tutélaire aux côtés d’héraclite, eschyle et sophocle tels qu’ils apparaissent dans sa page d’ascendants pour l’an 1964. dans le cadre du premier chapitre de cette dernière partie, nous verrons comment ces voisinages donnent à lire des présences conjuguées construites sur des effets de reconnaissance de l’un par l’autre dans une correspondance entre réel et imaginaire. ce qui sera vérifié par l’expression du désir d’un paysage et d’un territoire en partage. ce deuxième chapitre fera valoir la poésie de la peinture chez rené char dans une « double appartenance 8». pour conclure, nous veillerons à mettre en exergue l’importance de l’art et de la peinture dans la poésie et les écrits de char en signifiant exhaustivement comment l’art est, aux yeux du poète, un « droit perpétuel de passage » car « en dépit des attentats, l’art est la braise sur laquelle s’égoutte le filet d’eau d’une rosée très ancienne quand roland barthes s’interroge : « la peinture est-elle un langage ? », l’un des éléments de réponse qu’il propose et qui nous semble s’adapter à la fois à l’esprit de notre démarche analytique, et à l’engagement de l’écriture charienne dans l’art, est formulé ainsi : ce ne sont pas les disciplines qui doivent s’échanger, ce sont les objets : il ne s’agit pas d’ « appliquer » la linguistique au tableau, d’injecter un peu de sémiologie dans l’histoire de l’art ; il s’agit d’annuler la distance (la censure) qui sépare institutionnellement le tableau et le texte. quelque chose est en train de naître, qui périmera aussi bien la « littérature »que la « peinture » (et leurs corrélats métalinguistiques, la critique et l’esthétique), substituant à ces vieilles divinités culturelles une « ergographie » généralisée, le texte comme travail, le travail comme texte.10 dégagés de tout faux-semblant, les sentiers de la poésie charienne s’ouvrent au regard de l’art qu’ils légitiment en lui insufflant un accord et une voix première. une telle disposition crée des lieux et des dispositifs au miroir dont la moindre qualité est celle de « donner à voir », même si l’énigme au final demeure : l’évidence nouvelle ne souffrirait pas de démenti. il fallait la tenir pour certaine. l’imaginaire devenant visible et le réductible invisible, cet oeil-là, gravissant toute la lyre de la malignité, ne pourrait plus se tenir tranquille