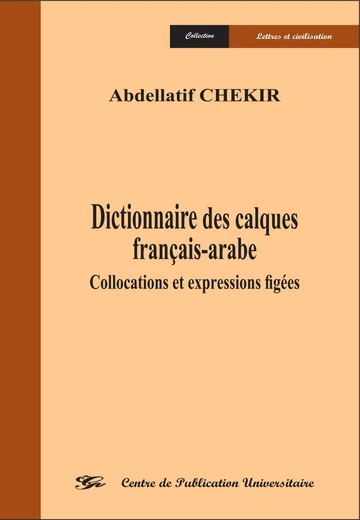« aucun peuple, en effet, N'a pu développer une culture entièrement autochtone, à l'abri de tout contact avec d'autres peuples, qu'il s'agisse de guerres ou de relations économiques, si bien que nécessairement, sa langue s'est trouvée en rapport avec une ou d'autres langues, et en a reçu une influence quelconque, si minime soit-elle ».1 1. considérations historiques sur le contact de l’arabe et du français la proximité géographique, l’histoire commune, les échanges commerciaux, l’interférence culturelle et la circulation du savoir sont autant de facteurs qui favorisent le contact des langues et l’influence des unes sur les autres. ce contact se traduit par la migration des mots et des expressions d’un territoire à l’autre et l’appropriation ou le rejet de ces unités par la langue emprunteuse. en effet, plus de soixante-dix ans de présence française sur le territoire tunisien a eu pour effet la pénétration de la langue française dans l’administration puis dans le système éducatif afin d’initier les apprenants à cette langue et de leur inculquer la culture française conformément au programme fixé pour la « mission civilisatrice ». cette présence s’est consolidée même après l’indépendance de la tunisie, période où l’on a accordé un statut privilégié à la langue française. certes, « l’arabisation est … le premier des impératifs, la condition nécessaire pour la reconquête d’une identité occultée, dévalorisée même par la colonisation »2, mais, même si l’arabe est devenu la langue officielle comme le stipule la constitution tunisienne de 1959, les responsables, à cette époque-là étaient conscients que cette langue n’est pas à même de véhiculer le savoir dans tous les domaines de la connaissance parce qu’elle n’a pas été suffisamment « illustrée » pour parler comme du bellay, afin de jouer un tel rôle. autrement dit, la langue arabe n’a pas été enrichie par de nouveaux termes et de nouveaux lexèmes pour exprimer les acquis et les découvertes réalisés dans tous les domaines culturels, scientifiques et technologiques. ainsi une rupture brusque avec la langue et la culture du colonisateur n’avait pas été préconisée par les leaders de l’indépendance car « la profondeur de l’implication du français dans la société maghrébine était telle que le changement de langue ne se réduisait pas à une opération linguistique, mais entraînait des conséquences sociales, politiques, culturelles »3. il fallait plutôt accorder un statut particulier à la langue française pour permettre cette ouverture sur le monde moderne car la langue arabe, demeurée figée, n’était pas encore prête à assumer une telle fonction, en attendant qu’elle soit mise à jour pour pouvoir supplanter progressivement la langue française. une telle situation a favorisé l’élargissement de la connaissance de la langue française à la faveur de l’extension de l’enseignement où la plupart des matières étaient enseignées en français. cette politique linguistique adoptée par la tunisie au lendemain de l’indépendance, doublée d‘une expansion des moyens audiovisuels, a développé un contexte propice au bilinguisme défini par dubois et al. « comme la situation linguistique dans laquelle les sujets parlants sont conduits à utiliser alternativement, selon les milieux ou les situations, deux langues différentes »4 . cette définition s’applique parfaitement au cas de la tunisie. en effet, de par leur connaissance de l’arabe et du français, les locuteurs tunisiens instruits recourent indifféremment à ces deux langues dans les échanges verbaux, qu’il s’agisse d’une manière successive ou simultanée à travers le code switching qui se manifeste, dans ce cas précis par l’irruption de mots français dans un discours en arabe littéral ou dialectal. ce phénomène est très courant chez les locuteurs tunisiens et plus particulièrement dans le parler des jeunes influencés par les moyens de communication qui pratiquent l’alternance codique à longueur de journées. ce bilinguisme est également un terrain favorable à l’emprunt dans toutes ses formes. en effet, nous constatons aujourd’hui un transfert massif en arabe, de mots et d’expressions à partir du français, moyennant une certaine adaptation au système morpho-phonologique et syntaxique propre à la langue arabe au cas où cela s’imposerait. ce sont autant de néologismes qui permettent de doter la langue arabe de nouvelles expressions et de nouveaux termes pour combler certaines lacunes et enrichir son expressivité.