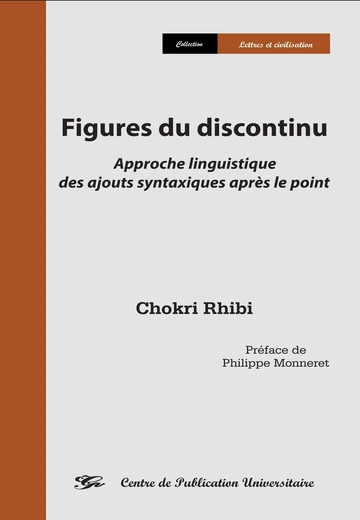Les études sur le détachement syntaxique, la dislocation, l’apposition et autres phénomènes apparentés sont abondantes. notre objectif, dans cet ouvrage est l’examen d’un cas particulier de détachement : les ajouts syntaxiques après le point. il s’agit certes de fragments détachés, mais contrairement à la norme, le détachement est marqué par un point et non par un signe de ponctuation traditionnel comme la virgule, les deux points, ou le tiret. les syntagmes placés après une ponctuation forte comme dans : a- « il reste quelques jours pour convaincre gbagbo de s’effacer, confie un expert français. par les pressions et les sanctions. (l’express, 2011)1 b- tous rêvent d’une nouvelle gauche. plus libérale, moins idéologue (du moins en apparence) franchement européenne.2 c- mais david cameron 'est pas dénoncé comme un inquiétant souverainiste, un horrible populiste, un dangereux nationaliste. il est accueilli avec respect dans les capitales européennes. il a entrepris une tournée. pour « discuter ». il 'a pas encore d'avis sur sa consigne de vote. (marianne, lundi 08 juin 2015) d- « je ne pense pas que ça soit une chance pour europe écologie. ce genre de propos, c’est lourd à gérer. violent, injuste et contre-productif. il faut avoir du respect pour les militants. ce sont des gens qui sont dans l’altruisme, la générosité. on ne peut pas les insulter ». (marianne, 2010) ne peuvent être traités comme des cas de détachement ordinaire.ce type de détachement ne concerne pas seulement les séquences averbales dont le noyau est le plus souvent un adjectif, un adverbe ou un nom. de nombreuses subordonnées peuvent figurer, contrairement à la norme, après une ponctuation forte : e- « le service est très bien et les chauffeurs formidables... mais pourvu que ça dure. » (20 minutes.fr). f- l'international français (…) a joué 60 minutes et a été salué par arsène wenger. «cela a été difficile pour lui, mais il a tenu 60 minutes, et il ne s'est pas blessé. il a réalisé une performance acceptable, malgré la fatigue. il a joué dans un rôle plus défensif car cela lui permet de jouer face au jeu. je pense qu'il peut s'en sortir dans ce rôle plus en retrait. en tout cas, il a tous les atouts pour le faire». pourvu que ça dure. (ibid.) g- les mouvements d’un léopard des neiges n’ont plus de secret pour les employés du zoo tama de tokyo. enfin, presque. mardi, ils ont participé à une simulation pour se préparer à la fuite éventuelle d’un animal. sauf que la bête n’était évidemment pas réelle, mais jouée par un employé… en costume de léopard. (ibid.) h- il pensait sans doute se faire remarquer auprès de ses camarades. sauf que la soirée a pris une tournure dramatique. un habitant de colmar, âgé de 27 ans, est tombé mardi matin vers 2h du troisième étage d’un immeuble situé rue de la galtz. (ibid.) i- suivre la compétition cannoise n’est pas un boulot désagréable, loin s’en faut. a condition que les 22 films en question soient à la hauteur de l’évènement. (20 minutes.fr) j- le numérique, que vous appelez de vos voeux, impose donc à notre école une ambition démocratique plus haute qu'auparavant car il condamnera les élèves les moins formés aux pires préjugés, aux erreurs les plus graves, aux relations les plus incohérentes. tandis que les autres, l'élite qui sait distinguer le bon grain de l'ivraie, renforceront encore plus leur statut de « nantis du savoir ». (marianne, 2015) ce type d’emploi n’est pas propre aux discours médiatiques. de nombreux auteurs n’hésitent pas à placer une subordonnée après une ponctuation forte. de plus, toutes les subordonnées se prêtent apparemment à ce type de détachement atypique. le phénomène mérite d’être étudié de plus près pour en dégager les effets de sens qui en résultent. une attention particulière devrait être accordée surtout aux emplois relevés dans les textes littéraires : k- ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que viendrait m’embrasser quand je serais dans mon lit. mais ce bonsoir durait si peu de temps, (…) elle redescendait si vite, que le moment où je l’entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m’aurait quitté, où elle serait redescendue. de sorte que ce bonsoir que j’aimais tant, j’en arrivais à souhaiter qu’il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n’était pas encore venue. (m. proust, du côté de chez swann) la réflexion sur ce type de détachement implique forcément une reconsidération des notions de phrase, proposition, subordination, rection….et d’une certaine terminologie mise en place par la grammaire traditionnelle. nous savons que les notions de dépendance et de hiérarchie sont déterminantes dans la définition syntaxique des subordonnées. par conséquent, la relation de dépendance qui unit la principale à la subordonnée est même considérée comme une relation de rection. cependant, nous ne pouvons dire que le degré de dépendance est vraiment le même pour toutes les subordonnées. certes, les circonstancielles jouissent d’une certaine liberté quant à leur position dans la phrase. nous montrerons, dans les chapitres qui suivent, que la notion de phrase de même que celle de subordination sont inopérantes. d’ailleurs, certains linguistes s’inscrivant dans la théorie de la macrosyntaxe du gard ont proposé d’abandonner ces notions. en effet, benzitoun précise à ce propos que les analyses portant sur la subordination n’ont cessé d’être « affinées jusqu’au célèbre article de haiman et thompson(1984)3 prônant l’abandon du concept de subordination à cause de son incapacité à embrasser la diversité des relations qui peuvent exister entre deux constructions verbales comme nous le révèlent les usages attestés » (benzitoun, 2006)4. poursuivant sa réflexion, l’auteur ajoute que « à la suite de attal(1999)5, et de nombreux autres chercheurs, on dira donc que « l’on peut se passer de la subordination qui, de toute façon, recouvre des phénomènes hétérogènes »6 pour ce qui nous intéresse, nous essayerons d’examiner ce rapport de dépendance et nous nous interrogerons sur le statut de certaines subordonnées, notamment celles introduites après une ponctuation forte. la fonction du subordonnant est également problématique comme le montre d’ailleurs le fonctionnement des locutions (de sorte que, à condition que, sauf que) dans les exemples susmentionnés. ces reproches formulés à propos des subordonnants remettant en question la relation de dépendance entre subordonnée et principale peuvent être enrichis et appuyés par un autre aspect qui nous intéresse plus particulièrement et qui n’a pas été pris en considération par les linguistes auxquels nous avons fait référence jusque là : il s’agit certes de cette ponctuation forte qui isole certaines subordonnées et qui ne fait que rendre plus explicite l’inadéquation du critère de dépendance tenu comme un trait définitoire de la subordination. « sur la nature du lien de subordination, le problème tient à ce qu’il y a en fait plusieurs fonctionnement syntaxiques distincts qui se cachent derrière l’appellation unitaire de subordination dont seulement certains recouvrent une relation de dépendance grammaticale. plusieurs relations syntaxiques sont à l’oeuvre, diversité que masque cette unique qualificatio