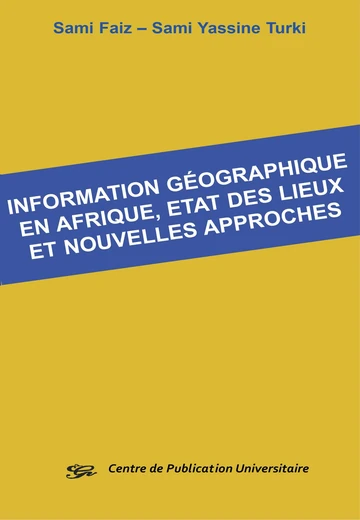Information Géographique En Afrique, Etat des Lieux et Nouvelles Approches
Détails de la publication
Mise en place d’un sig dans la commune urbaine de mopti, mali – information géographique numérique pour la planification et la gestion urbaine en tunisie – gestion des données urabaines et périurbaines au cameroun : evolution, problèmes et approches d’actions – l’apport des répértoires de toponymes dans la diffusion de l’information géographique : l’exemple des pays d’afrique centrale – une réflexion de conception d’un géo-framework de gestion du risque inondation en zones urbaines : méthodes, modèles, outils et données – production de données sur l’occupation du sol à partir de connaissances extraites de bases de données géographiques – modélisation de l’information géographique par ontologie spatio-temporelle, floue et lourde pour l’interprétation des images de télédetection.
Préface
La maîtrise de l’information géographique constitue un enjeu de taille dans les processus de développement socio-économique et dans la planification et la gestion territoriale. plus les caractéristiques physiques et socio-économiques des territoires sont connues, plus on est à même de mieux orienter l’action publique sur ces espaces, d’un côté, et d’encadrer toutes les autres formes d’intervention, de l’autre. dans les pays en développement et notamment en afrique, l’étalement urbain, surtout des grandes métropoles, soulève des questions très importantes de transport, d’équipement, d’habitat et de réseaux d’eau et d’énergie. les etats se trouvent dans des situations complexes de planification et de gestion de ces espaces qui concentrent une part essentielle du pouvoir économique et administratif mais qui demeurent caractérisés par des inégalités très importantes que les dynamiques des territoires ne fait qu’augmenter au fil des jours. ainsi, le besoin en information géographique reflétant l’état réel des territoires, surtout urbains, se fait sentir essentiellement au niveau de la planification urbaine et socio-économiques de ces territoires. le poids important du secteur informel (économie, habitat, transport…) fait que l’on a des difficultés pour disposer d’une connaissance complète de l’état des territoires urbains, eu égard à la difficulté de mobiliser les données sur le secteur informel. la dynamique spatiale soutenue – souvent difficilement prévisible -rend de son côté complexe toute tentative de réduction des effets de l’urbanisation. les données disponibles et utilisées dans la planification territoriale risquent ainsi d’être complètement déconnectées de la réalité du terrain. le fait que les économies de certains etats tendent vers l’émergence ne fait qu’augmenter le besoin en informations pour accompagner convenablement le développement escompté. a la problématique de la planification et de ses besoins en données s’ajoute la question de la gestion au quotidien des réseaux urbains (transport, énergie, information…) dont les performances jouent beaucoup dans le développement des activités économiques et l’attraction des investissements extérieurs. le même constat peut être appliqué pour ce qui est de la tendance à la décentralisation et au développement local qui visent d’autres manières pour aborder le développement. ces tendances ne font qu’accroître le besoin continue en informations localisées. une analyse rapide de la situation actuelle des pays africains montre que depuis l’ère coloniale caractérisée souvent par la production d’une cartographie de base, les efforts déployés, tant sur le plan institutionnel et technique, n’ont pas permis de disposer convenablement de données nécessaires pour une connaissance adéquate des espaces urbains, susceptible d’accompagner comme il se doit les phases de planification et de gestion des territoires. la cartographie topographique demeure obsolète et les cartes d’occupation du sol peinent à suivre les évolutions rapides de l’urbanisation, non seulement en termes d’étalement urbain, mais aussi en termes de mutations des espaces déjà occupés. face à ce constat, plusieurs tentatives ont été testées afin d’offrir des moyens à la fois rapides et peu onéreux de production de données. ces essais se sont principalement appuyés sur les apports des technologies de l’information et de la communication (tic). plus particulièrement, les avancées rapides en matière de télédétection et positionnement par satellite ont offert le moyen de contourner les méthodes classiques d’élaboration des cartes topographiques et autres cartes thématiques. au-delà des caractères prototypiques de ces expériences, il demeure intéressant de se demander dans quelle mesure, les nouvelles technologies de collecte et de gestion de données géographiques ont-elles permis une production des données nécessaires pour l’activité socio-économique et la planification/ gestion territoriale ? la finalité de cet ouvrage s’articule autour de cette question principale. il s’agit de donner une lecture de la situation actuelle ainsi que des avancées méthodologiques dans la constitution des bases de données géographiques et autres informations géographiques numériques en afrique, essentiellement en ce qui concerne les espaces urbains. cette lecture peut constituer un point de départ pour une consolidation des méthodes utilisées ou bien pour une analyse et des orientations en matière d’organisation des informations et des processus de leur production. cette finalité est de nature à ouvrir des perspectives en matière de généralisation des démarches et d’approfondissement des approches. dans sa première partie, et tout en identifiant les situations particulières, cet ouvrage essaye de dégager les traits qui caractérisent les données existantes, l’organisation des processus de leur production et les modalités de leur gestion et de leur diffusion. l’objectif n’étant pas uniquement de caractériser l’environnement de production utilisation des informations géographiques mais aussi de comprendre le contexte d’émergence/application des nouvelles méthodes de production de données - qui sont traitées dans la seconde partie de l’ouvrage - et de livrer les éléments pour une analyse adéquate du degré d’adoption de ces techniques dans les processus existants de production cartographique. cet ouvrage tente ainsi dans une première perspective de dresser un tableau des situations actuelles dans certains pays africains en matière de données cartographiques existantes et des modes de productions de l’information géographique, notamment en milieu urbain. l’ouvrage s’intéresse aussi aux méthodes de production des informations géographiques numériques, il traite, en particulier, de deux types de méthodes : les méthodes usuelles de production des informations géographiques numériques dont l’opérabilité les limites d’application sont analysées et essentiellement les nouvelles méthodes issues notamment de l’exploitation des apports des nouvelles technologies liées aux systèmes d’information géographiques, à la télédétection, aux systèmes de positionnement et autres domaines d’émergence des possibilités de production des données à référence spatiale. les approches à analyser découlent des travaux de recherche comme de ceux développés ou expérimentés dans le champ opérationnel. les chapitres de la deuxième partie de cet ouvrage font le bilan de ces expériences. les auteurs ont étudié les conditions d’intégration des méthodes développées dans les processus réels de production/utilisation de l’information géographique numérique. nous avons choisi comme premier chapitre de cet ouvrage, le travail de cécilia meynet-diakité sur la mise en place d’un sig dans la commune urbaine de mopti au mali. ce chapitre interroge la problématique ce cet ouvrage à travers le projet d’une commune malienne, dans un contexte de début de décentralisation et d’environnement général caractérisé par la faible production des données. ce chapitre développe également des aspects institutionnels et analyse l’intégration des outils mis en place dans les processus locaux de planification et de gestion. l’interaction avec le politique est également une des dimensions analysées par l’auteur. dans le second chapitre, jihène ghiloufi et sami yassine turki font un bilan des travaux entrepris durant les dernières décennies en tunisie en vue de constituer des systèmes de production ou d’analyse des informations géographiques, notamment dans la capitale du pays. cet état des lieux, après une lecture historique et urbanistique, caractérise les systèmes de production et de gestion des informations géographiques en incluant les acteurs institutionnels, les projets nationaux et les projets décentralisés. l’analyse a abordé également les aspects institutionnels, le rapport au processus d’urbanisation et l’interaction avec les processus de planification et de gestion territoriale. dans le troisième chapitre, adolphe ayissi eteme analyse le contexte d’extension urbaine au cameroun, dont une partie demeure spontanée face à l’échec des politiques de l’habitat. ce contexte d’ « urbanisation de la pauvreté » fait appel nécessairement à une production et une gestion de l’information géographique à même d’assurer l’encadrement nécessaire de ces processus mais que ce besoin se heurte au manque de moyens financiers qui créent des difficultés de cartographie et de maîtrise des modes d’occupation et de l’utilisation du sol. l’auteur passe en revue les apports des multiples projets et travaux de recherche dans ce sens, qui, malgré leur intérêt, demeurent disparates et sous exploités. ce constat est derrière la proposition de l’auteur d’une plateforme fédératrice de gestion de données hétérogènes et incomplètes pour la prise de décision en milieu urbain au cameroun. le quatrième chapitre proposé par marius massala et martin paegelow traite des deux questionnements de cet ouvrage. il analyse en premier lieu le contexte des informations géographiques pour la gestion forestière dans les pays d’afrique centrale, examine ensuite les systèmes existants et finalement développe une proposition basée sur les répertoires de toponymes pour dépasser les lacunes constatées. les travaux présentés par mohamed missaoui et mohamed djebbi dans le cinquième chapitre ont pour objet la conception et la mise en place d’un système de modélisation des inondations en zones urbaines. ce système est centré autour d’une base de données municipales et d’un ensemble de modèles numériques de simulation des inondations. ce système a été déployé au cas de la commune de megrine en tunisie et a été évalué. l’analyse porte également sur le potentiel de la base de données municipale. le sixième chapitre de sami yassine turki et sami faiz s’intéresse à la production de données sur l’occupation du sol à partir de connaissances extraites de bases de données géographiques. il expose un ensemble d’approches visant la production de données sur l’occupation du sol en milieu urbain dans un contexte de rareté des informations disponibles. ces approches essayent d’exploiter ces informations existantes pour produire de nouvelles données sur l’occupation du sol et son évolution dans le futur, comme le montrent les expérimentations menées sur le contexte tunisien. dans le septième chapitre, wassim messaoudi, imed riadh farah et basel solaiman se basent sur une ontologie pour représenter les connaissances de l’image de télédétection. a travers l’ontologie, les auteurs proposent de modéliser les entités géographiques, leurs propriétés, les relations spatiales entre elles et les contraintes de domaine. l’ontologie proposée est destinée également à modéliser les imperfections entachant l’information géographique en se basant sur les ensembles flous. l’expérimentation effectuée sur une étude de cas en tunisie est destinée également à montrer le potentiel de la proposition.
| Titre | ISBN | Volume |
|---|
| Titre | ISBN | Langue |
|---|