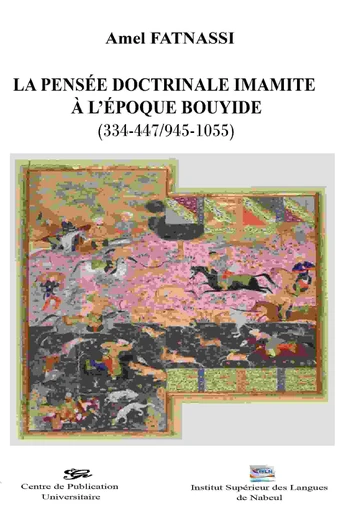Souvent, une pensée connaît mieux ce dont elle cherche à se détacher que ce qu’elle cherche à embrasser. il se trouve alors que l’intention est plus décidée que la marche, dégressive par moments, progressive par d’autres moments, dynamique cependant dans tous les cas, dans ses détours comme dans ses retours, dans la formulation, comme dans la dé-formulation ou la reformulation de ses concepts et de ses objectifs. ce n’est pas que la marche soit ici hésitante, c’est juste que le chemin s’ouvre à mesure que le cheminant avance. cette réalité, rapidement esquissée, s’applique à la pensée imâmite qui se développa au cours du siècle bouyide, une pensée qui n’envisagea le recours à la tradition que pour mieux repositionner celle-ci dans le siècle, mieux l’inscrire dans la progression de l’histoire, avec, au mieux, — mais ce n’était pas assuré d’avance — une nouvelle façon d’être et de penser. la tradition fut ainsi principalement visée par ce projet. elle ne résistera pas à l’offensive de la raison, qui cherchait à la réduire à sa formulation la plus incontestable, cela au risque de bousculer la foi en cette tradition. nous espérons pouvoir fournir une matière susceptible de montrer l’évolution de la pensée imâmite aussi bien sur le plan dogmatique que sur le plan juridique. quatre éléments ont eu leur influence sur cette évolution ; ils s’imposeront de fait dans le développement de notre travail. 1) le temps, c’est-à-dire la conjoncture historique, car nulle évolution qui ne puisse tenir compte d’une certaine temporalité. 2) l’idéal imâmite, celui-ci étant un horizon perceptible, une promesse aussi bien terrestre qu’eschatologique. 3) la puissance de la raison et la force démonstrative qu’elle entreprend. 4) une conscience enfin, car nulle évolution qui soit inconsciente de ses finalités. c’est dans ces directions que nous allons orienter notre travail. le champ de son application est celui qui sépare la tradition imâmite originelle, « ésotérique non rationnelle », de la tradition « juridique rationnelle »1. il y avait là un chemin à parcourir, et la pensée imâmite qui nous intéresse, celle qui évolua au cours du siècle bouyide (de 334/945 à 447/1055), l’a résolument parcouru. nous avons tenu à ce que nos sources traduisent aussi bien la pensée que la période indiquées. nous avons ainsi choisi de nous intéresser en particulier à des auteurs comme ibn bâbûye al-qummî (m. 381/991-2), al-shaykh al-mufîd (m. 413/1022) al-sharîf al- murtadâ (m. 436/1044) et abû ja‘far al-tûsî (m. 460/1066-7). le premier d’entre eux, connu sous le nom d’al-sadûq, représenterait l’école traditionaliste de qum, ayant été un fidèle rapporteur de traditions attribuées aux imâms. cependant, nombreuses sont les preuves qui nous font découvrir ibn bâbûye faisant appel à l’interprétation rationnelle de la tradition imâmite à fin de de dégager sa pertinence et sa puissance logique. c’est pour cette raison que nous le situons, après h. modarressî, entre le littéralisme des traditionalistes et la spéculation rationnelle des théologiens de l’école de bagdad2 ; d’où notre choix de nous pencher sur son oeuvre, celle-ci pouvant être assimilée à une passerelle entre les deux approches de la tradition mentionnées ci-dessus. les trois successeurs d’ibn bâbûye, al-mufîd, al-murtadâ et al-tûsî, s’imposèrent comme les premiers grands représentants de l’imâmisme rationaliste à l’époque bouyide. il faut dire que l’écart qui sépare traditionalisme et rationalisme, ou selon l’appellation tardive akhbarî etusûlî3, ne s’est pas limité aux affaires de dogme et de droit. l’implication dans le siècle les différenciait tout autant. les traditionnistes choisirent de se tenir à l’écart des vicissitudes politiques. les rationalistes, eux, optèrent au 1 m. a. amir-moezzi, le guide divin dans le shi ‘isme originel : aux sources de l’ésotérisme en islam, verdier, 1992, pp. 33-48 ; voir également du même auteur « l’islam iranien », dans encyclopédie des religions, i, bayard éditions, 1997, p. 804. 2 dans an introduction to shî‘î law, ithaca press, london, 1984, p. 39, h. modarressî compte en effet, comme membres de ce qu’il appelle « l’école intermédiaire », à côté d’ibn bâbûye al-qummî, abu’l fadl muhammad al-sâbûnî al-ju‘fî, ja‘far b. muhammad b. qûlawayh al-qummî et ahmad b. muhammad b. dâwûd b. ‘ali al-qummî. 3 newman, a.j., the development and political significance of the rationalist (usuli) and traditionalist (akhbari) school in imami shi’i history from the third/ ninth to the tenth/ sixteen century, a, d., thèse de doctorat, ucla, los angeles, 1986. contraire de « collaborer » avec les abbassides et leurs princes bouyides. du reste, c’est sans doute al-mufîd qui traduit le mieux la différence entre les deux courants. « les traditionnistes traditionalistes, dit-il à ce propos, transmettent le bon grain et l’ivraie (al-ghathth wa al-samîn)…ce ne sont des adeptes ni de l’enquête ni de la recherche ; rien dans leur pensée qui dégagerait discernement ou esprit. ce qu’ils transmettent est un mélange du vrai et du faux … »1. tout le projet du courant rationaliste, — une vision critique du dogme et de la tradition —, se trouve ici définie : repenser la tradition scripturaire. il faudra également repenser cette notion fondamentale qu’est le ‘ilm, originellement « la science initiatique secrète » et plus tard « le droit canon et la théologie dialectique ». le même effort portera sur al-‘aql, qui, d’ « intuition sacrée » dans la tradition originelle, prend chez les rationalistes le sens de « raison »2. nous devons reconnaître ici, au seuil de notre travail, souligner l’existence de tendances rationalistes antérieures au temps des bouyides. les textes attribuent en effet une volonté de détachement par rapport à la tradition présente chez abû basîr muhammad b. al- layth b. al-bakhtarî al-murâdî, qui n’aurait reconnu à l’imâm mûsâ al-kâzim aucune compétence en matière de droit3. jamîl b. darrâj, le plus érudit des compagnons de ja‘far al-sâdiq, ou encore fadl b. shâdhân al-naysabûrî (m. 260/ 873-4), yûnus b. ‘abd al-rahmân, zurâra b. a‘yan al-kûfî, ou encore ‘abd allâh b. bukayr, des compagnons connus des imâms, étaient tous favorables à l’extraction des règles juridiques à l’aide de l’analyse logico-rationnelle des sources4. plus tard, ibn abî ‘aqîl, dans la première moitié du ive/xe siècle, et ibn al-junayd, vers le milieu de ce siècle, auraient représenté « la première école de droit déductif shi’ite »5. ibn abî ‘aqîl confère au coran, en matière de droit, une validité juridique absolue, réduisant par là la portée juridique des traditions. ibn abî ‘aqîl était plus apprécié des rationalistes1, contrairement à ibn al-junayd, qui défendait al-qiyâs, le raisonnement par analogie, il considérait alkhabar al-wâhid, la tradition à chaine unique, comme source fiable de droit et jugeait positivement l’usage du ra’y, le jugement personnel2 ; d’où les critiques d’al-mufîd, nous le verrons bien, à son égard. la notion même d’occultation, al-ghayba, centrale dans le shi’isme originel, remise en question par la spéculation rationalisante de penseurs comme abû sahl al-nawbakhtî ou ibn qiba al-râzî3. ces tentatives déterminaient une orientation et annoncaient déjà une certaine évolution logico-dogmatiques, autant de points d’appui et de départ pour le courant rationaliste. pareilles démonstrations sont justement présentes dans l’oeuvre d’al-sadûq, comme dans les ouvrages d’al-shaykh al-mufîd, d’al-murtadâ et encore chez abû ja‘far al-tûsî. nous confronterons leurs idées, déterminerons les caractéristiques de l’argumentaire de chacun, observerons aussi bien l’évolution des opinions de chacun que l’évolution de la pensée, ─ produit de contributions singulières ─, qu’ils portent tous réunis. est-il nécessaire de rappeler qu’observer l’évolution au sein même du courant rationaliste nécessite un certain retour, une connaissance précise du courant ésotérique originel. chaque pensée profite d’un antécédent. le courant rationaliste sera à son tour, forcément, le point d’appui d’une relance dogmatico-intellectuelle, raison pour laquelle, avec al-tûsî, la pensée qui nous intéresse ici gagna beaucoup en valeur démonstrative, ce dernier ayant tiré profit du trajet déjà parcouru par ses prédécesseurs, par al-sadûq, al-mufîd et al-murtadâ. il est important dans cette introduction que nous définissions la démarche méthodologique de notre travail. trois parties, composées de chapitres distincts évoquant chacune une question ponctuelle, ont pu être définies. la première partie est consacrée à un ensemble de préliminaires destinés à la mise en place du cadre général du sujet. il y sera premièrement question de la conjoncture historique globale, ensuite des auteurs sur lesquels nous avons choisi de concentrer notre intérêt, et, dans une dernière section, des principales problématiques que le courant rationaliste s’était attaché à reprendre, à analyser et à défendre. nous irons chercher ces problèmatiques dans un ouvrage particulièrement représentatif de la pensée ésotérique originelle, les basâ’ir al-darajât d’al-saffâr al-qummî (début du ive/xe siècle), cela nous aidera à mesurer l’effort qu’allait être fourni par les rationalistes pour se démarquer du courant ésotérique puissamment représenté dans les basâ’ir. il sera également question dans cette partie préliminaire de l’importance du contexte bouyide dans l’installation d’une théologie imâmite rationaliste qui tentait de mettre fin à une vision ésotérique de l’imâmisme pourtant, si caractéristique du shi’isme ancien. avec les bouyides en effet, à la faveur des princes de cette dynastie, l’imâmisme devenait moins secret, gagnait pour ainsi dire en extériorité. la prolixité des auteurs auxquels nous allons nous intéresser témoignait en effet de cette ouverture. nous ne manquerons pas de fournir les informations aussi bien biographiques que bibliographiques susceptibles de nous renseigner sur la fécondité de la pensée de chacun d’entre eux. la deuxième partie traitera des usûl al-dîn, des principes de la religion. la troisième sera consacrée aux usûl al-fiqh, aux principes du droit. il sera question non seulement de déterminer le contenu de ces notions, telles qu’elles ont été pensées et présentées par nos auteurs, mais aussi de rappeler que la distinction entre les deux domaines, entre usûl al-fiqh et usûl al-dîn, était tardive et que le débat était intense quant au contenu de chacun de ces deux usûl. nous nous donnerons l’occasion d’expliquer cette problématique dans la deuxième et la troisième partie, au moment d’évoquer les principes de la religion et ceux du droit. l’occasion sera alors propice de nous rendre compte de l’évolution de la pensée imâmite à ce sujet, une pensée paradoxale, intransigeante mais conciliante, ouverte mais exclusive, séculière mais aussi métaphysique, hermétique et pourtant méthodique et intelligible. ces dualités seront méthodiquement démontrées, expliquées et interprétées.elles prendront dans les écrits de nos auteurs des formes dogmatiques, tels que le bien et le mal, le vrai et le faux, le légitime et l’illégitime. les spéculations par lesquels ils les reprenaient n’avaient pas pour but de les détruire mais de permettre à la raison de les englober. c’est dans cet état d’esprit que seront reprises des questions aussi centrales que le coran, sa transmission et sa valeur juridicomorale, ou encore la tradition du prophète et celle des imâms. chaque tradition nécessitait une reprise et une réappréciation. repensées étaient également des questions comme la justice, le consensus ou la résurrection, dans une réflexion nouvelle sur le temps et le devenir de l’homme.