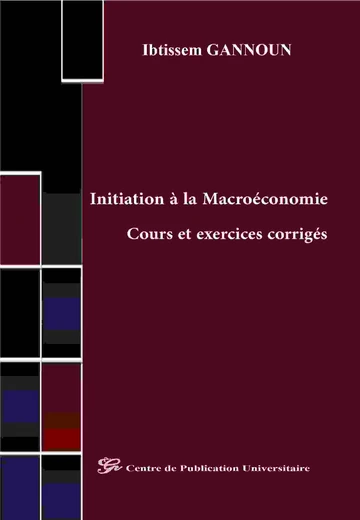Le début des premiers courants de pensée économique remonte à la fin du xviiième et début du xixème siècle. il se confond approximativement avec le début de la révolution industrielle. adam smith, son célèbre traité recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, première étude sur ce thème, lui valut d'être considéré comme le père fondateur de la science économique moderne. les grands courants de la pensée économique s’articulent essentiellement autour de quatre écoles dont l’école classique, l’école néoclassique sous jacente de la précédente, l’école marxiste et l’école keynésienne. adam smith (1723-1790), chef de fil du courant classique et ricardo (1772-1823), analysent les principales fonctions économiques et se fient aux mécanismes spontanés du marché, pour assurer les grands équilibres et la croissance économique. l’école classique est adepte du libre-échange. la pensée classique s’articule autour de trois fondamentaux, soient la liberté des individus, le pouvoir régulateur de marché et le non interventionnisme de l'état dans la vie économique. l'état se voit accorder le rôle du gendarme. l’école néoclassique, dont menger (1840-1921) et walras (1834- 1910) sont les fondateurs, s’est donnée l’approfondissement et la rénovation de la pensée classique, d'où son nom. la problématique des néoclassiques porte sur la formation des prix et sur la répartition de la richesse produite. les classiques et les néoclassiques forment le noyau du courant libéral. l’école marxiste, laquelle école tient son nom à son porte drapeau karl marx (1818-1883), s’est distinguée par sa critique de l'économie libérale. marx considère que l'économie de marché est profondément injuste et inégalitaire. il est à l'origine de l'économie socialiste. l’école keynésienne est due à son fondateur keynes (1883-1946). keynes considère que l'économie de marché 'est que rarement en équilibre, elle est généralement en équilibre de sous emploi. en ce sens, l'état doit intervenir dans la vie économique pour rétablir les grands équilibres. dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936), il justifie le recours au déficit public pour stimuler l'emploi. a. individualisme méthodologique versus holisme méthodologique dans les soubassements des analyses économiques, nous retrouvons deux concepts contradictoires, soient l´individualisme méthodologique et le holisme. “l’individu” s’érige au centre de l’individualisme méthodologique, il est supposé rationnel mobilisant les informations à sa disposition en vue d’optimiser son comportement. le holisme, en revanche, accorde une place cruciale à la collectivité, laquelle constitue la véritable entité de base. en dépit de la grande diversité d’écoles et de courants de pensées économiques, l’idée d’une orthodoxie néoclassique est actuellement prépondérante pour laquelle seul le facteur individuel importe dont la rationalité est définie par l’axiome de la maximisation. a la différence du modèle néoclassique, le modèle hétérodoxe keynésien repose sur une approche macroéconomique et holistique où les mécanismes d’ajustement de marché sont imparfaits, et où l’intervention publique est nécessaire afin de les compléter, les encadrer et les réguler par le biais des politiques économiques conjoncturelles ou via des interventions structurelles. par ailleurs, la théorie néoclassique véhiculée par l’individualisme méthodologique, fut longtemps critiquée pour son caractère réducteur, lequel caractère est de nature à l’empêcher de rendre compte de la complexité des relations économiques notamment lorsqu’il s’agit de l’enjeu des problématiques du développement dans les pays du sud. b. macroéconomie et microéconomie l’analyse économique a pour objectif d’expliquer la façon dont les ressources rares sont réparties entre des utilisations concurrentes potentielles. l’économie est considérée comme la science des choix. l'analyse économique est complexe et revêt plusieurs aspects. généralement, nous distinguons les économistes selon la démarche qu’ils entreprennent. deux grands types de démarche s’érigent, soit l’analyse des choix au niveau des unités économiques et des marchés pris séparément, c’est l’objet de la théorie microéconomique, soit l’analyse des choix au niveau de la société dans son ensemble, laquelle analyse s’inscrit dans l’objet de la théorie macroéconomique dont l’objectif est l’étude des comportements des groupes d’agents, soit l’étude des interactions entre ces groupes sur les marchés nationaux et l’étude des relations que ces groupes entretiennent avec le reste du monde. la macroéconomie étudie, par ailleurs, l'économie à l’échelle d’un pays à travers les relations entre les grands agrégats économiques, tels que par exemple le revenu, l'investissement, la consommation, le taux de chômage, l'inflation, … elle tend à expliciter ces relations et à prédire leur évolution suite à une modification des conditions conjoncturelles. la microéconomie, en revanche, analyse les comportements du consommateur, de l’entreprise, ou encore de l’etat, dans leurs prises décisions