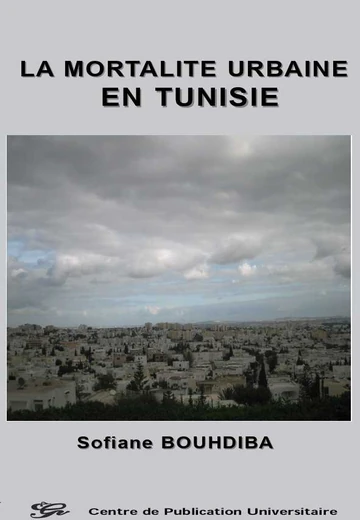La rochefoucauld se plaisait à dire : «la mort est comme le soleil, on ne peut la regarder en face. mais en regardant de côté, ou en promenant obliquement le regard, peut-être apercevrons-nous quelque chose ? »1. c’est précisément ce que nous tenterons de faire ici, en levant le voile, à travers une myriade de « regards obliques », sur l’un des phénomènes démographiques les plus mystérieux : la mortalité. l’objectif de cet ouvrage est de montrer au lecteur, de la manière la plus simple possible, de quelle manière il est possible d'observer et d’analyser la mortalité dans une population donnée. il s’agira, bien entendu, d’expliquer les techniques de compilation et de traitement d’informations sur les décès dans la société. l’originalité de cet ouvrage réside toutefois dans le fait qu’il propose une application directe des théories à un cas pratique : l’étude de la mortalité dans la tunisie urbaine. le choix du milieu urbain comme cadre d’étude a différentes raisons d’être. tout d’abord, l’urbanisation est sans conteste l’un des phénomènes les plus caractéristiques du monde moderne. la division de la population des nations unies estime que près de la moitié la population mondiale vit aujourd’hui dans des zones urbaines. en effet, en 2005, 3.177 milliards de personnes, soit 49.3 % de la population de la planète2 vivent dans des villes. les nations unies prévoient pour l’horizon2030 un total de 4.981 milliards de citadins, ce qui représenterait alors 60.2 % de la population mondiale. en tunisie, la part des habitants résidant en milieu urbain a bondi de 40.1 % en 1966 à64.9 % en 20043.cette urbanisation rapide, effrayante même, de la population tunisienne, nous amène à donner pleinement raison à abdelwaheb bouhdiba qui écrit, au terme de ses fructueuses quêtes sociologiques : «et de fait les sociétés arabes sont des sociétés qui n’arrêtent pas depuis deux siècles d’être en mutation ; en changement rapide par définition, ce sont des sociétés inachevées»4. l’auteur précisera sa pensée en écrivant plus loin que « la ville moderne est un modèle d’inachèvement »5.ce monde urbain grouillant, et qui s’est développé d’une manière plus ou moins contrôlée, a connu ces dernières décennies une telle évolution-révolution serait peut-être un terme plus approprié-sur les plans démographique, sociologique, culturel et économique, qu’il a suscité en nous le besoin d’en étudier les répercussions sur le phénomène de la mortalité. si la baisse de la fécondité a été une réponse de la société tunisienne à l’urbanisation, quid de la mortalité ? il y a là certes matière à réflexion, et c'est pourquoi nous avons jugé qu’il serait intéressant de tenter d'observer de quelle manière a évolué la mortalité dans le cadre de l’urbanisation de la population tunisienne. le choix du sujet a été également dicté par des mobiles d'ordre plutôt méthodologique. en effet, aux antipodes du monde rural encore avare en informations fiables, les données sur les décès urbains sont disponibles, et sont de surcroît de bonne qualité. cela s’explique, notamment, par le fait que le taux d’enregistrement des décès à l’état civil est, comme on le verra infra, suffisamment élevé dans les villes tunisiennes pour fournir des statistiques exploitables. enfin, le thème de la mortalité urbaine, représente un vaste champ de recherches, sinon vierge, du moins encore peu exploré. il convient d’autant plus de le défricher que l’urbanisation rapide de la population tunisienne a très certainement dessiné un nouveau paysage de la mort, paysage encore très peu connu parles démographes tunisiens mais également occidentaux. le présent ouvrage procède donc du besoin de proposer un travail de recherche, mais également un outil pédagogique qui aura le modeste mérite d’être inédit. a cet effet, la réflexion s’articulera autour de deux grandes parties, elles-mêmes subdivisées en différents chapitres. la première partie brosse le cadre théorique général de la mortalité urbaine. il s’agira, en particulier, de montrer comment on peut quantifier le phénomène de la mortalité, au travers d’indicateurs. il s’agira également de définir quelques concepts fondamentaux, et de faire la revue des grandes théories liées à la mortalité : que signifie la mort pour le démographe, comment peut-on définir une cause de décès ? où finit l’urbain et où commence le rural ? telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons d’apporter quelques éléments de réponse. cette première partie présentera également d’une manière exhaustive et critique les sources de la mortalité en milieu urbain. la deuxième partie du livre vise à emmener le lecteur du cadre théorique vers la pratique, en appliquant les concepts de mortalité à un cas concret. il s’agira ainsi de mettre en pratique les outils démographiques présentés précédemment. nous avons choisi de proposer au lecteur un examen de la mortalité différentielle dans la tunisie urbaine, c’est-à-dire que nous privilégierons à chaque fois un aspect déterminé, tel que le lieu du décès, le genre ou l’âge. cette partie propose également une réflexion étiologique, s’intéressant aux causes de décès. il s’agira de montrer au lecteur comment il est possible d’engager une démarche scientifique afin de vérifier si la tunisie urbaine a suivi le modèle de transition épidémiologique mis au point par omrane6 au début des années 1970. dans la foulée, un chapitre sera consacré à l'étude d’une cause de mortalité particulière, spécifique à la société urbaine tunisienne : la mortalité routière. la deuxième partie de l’ouvrage se fera en termes de perspectives, en examinant les conséquences sociodémographiques de l’augmentation de l’espérance de vie du citadin tunisien. nous tenterons à chaque fois de faire le point de la situation, en rapportant les faits de la manière la plus proche possible de la réalité, et d’engager quelques réflexions qui en susciteront peut-être d’autres, plus profondes, auprès du lecteur. en annexe figureront les résultats détaillés de quelques sources auxquelles nous nous sommes référées tout au long de notre réflexion. précisons pour clore cette préface que le présent ouvrage est issu d’une thèse de doctorat de démographie soutenue publiquement le 21 juin 2008 à la faculté des sciences humaines et sociales de tunis.