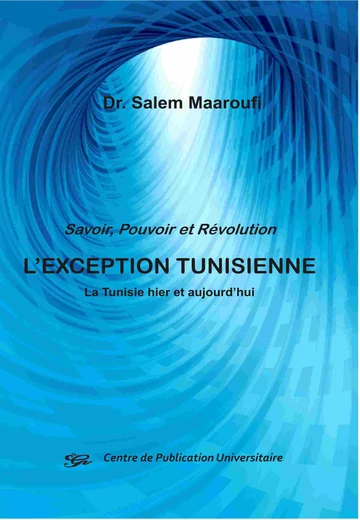Les révolutions dans les pays arabes sont le révélateur d'une situation chaotique, propre non seulement à la tunisie, l’egypte et la libye, le yémen, la syrie mais aussi à un grand nombre d’autres pays arabes et ce à tous les niveaux, politique, économique et social. nous ne voulons pas revenir ici sur le passé en en recherchant les causes accumulées ; plusieurs études ont été faites dans ce sens. mais notre propos serait plutôt orienté vers l’avenir : comment peut-on agir sur l’homme afin de changer les mauvaises habitudes, comment l’aider à dépasser un certain comportement qui bloque son épanouissement et les progrès de la société dans laquelle il vit. l’effondrement des régimes arabes renvoie à une double observation. la première est liée à l’égoïsme des etats possédant une machine de guerre considérable, qui veulent par tous les moyens exploiter la richesse des pays pauvres en plaçant, en remplaçant ou en soutenant des dirigeants indignes. la seconde est liée à la réalité interne de chaque pays arabe, à la fragilité et à l’illégitimité de leurs régimes. c’est à ce dernier point que nous nous intéresserons essentiellement pour la simple raison qu’un etat faible provoque des convoitises et est toujours la victime possible d’une ingérence extérieure. la faiblesse d’un etat est - t- elle liée à la fragilité des individus qui y vivent ? cette fragilité est-elle le résultat d’une éducation insuffisamment soucieuse de la formation d’un citoyen qui, de ce fait, se montrera incapable à la fois de maîtriser son propre destin et de contribuer à faire vivre un etat de droit ? il n’est pas dans notre intention ici d’entamer une discussion d’ordre politique mais plutôt d’effectuer une démarche critique relative au système éducatif dans ces pays. repenser la notion de citoyenneté et le rôle de chaque citoyen afin de retisser les liens souvent rompus à l’intérieur de ces sociétés nous paraît une nécessité voire une urgence. tous les changements qui ont marqué l’histoire des peuples ont commencé par ceux qui touchent l’appareil éducatif. il est tout à fait normal de dire, aujourd’hui, que les pays qui ont vécu des révolutions et des changements profonds en matière d’éducation sont précisément ceux qui, parce que les plus éclairés, ont le plus bénéficié des progrès tant il est vrai que la structuration de la pensée humaine ne peut se faire que dans une institution scolaire. seule l’école est capable de forger une culture « unique » qui marque telle ou telle société. son rôle premier est d’identifier au-delà des différences entre individus les traits culturels communs qui les rassemblent et les font agir de la même manière. autrement dit, l’école détermine un certain nombre de comportements communs à l’ensemble des individus, elle les encadre, les structure de façon à ce que ces comportements deviennent la marque de leur spécificité. c’est ce lien entre la culture et l’école que nous cherchons à mettre en valeur dans la société arabe. en d’autres termes, si la nature humaine est « une » au départ, les individus finissent par acquérir différents types de personnalités caractéristiques de groupes particuliers. dans une société dite traditionnelle, l’apprentissage d’une véritable citoyenneté liée à l’acquisition d’un savoir ne peut se faire qu’à l’intérieur de l’école. mais la formation de personnalités à la fois conscientes et équilibrées tout en restant fidèles à leur propre culture a-t-elle été jusqu’alors l’objectif essentiel de cette institution dans les pays arabes ? les sentiments de frustration, de honte et parfois de haine que l’ingérence extérieure a fait naître dans l’ensemble du monde arabe sont liés non seulement au caractère intolérable de celle-ci mais aussi à la vulnérabilité d’une personnalité arabe insuffisamment structurée et donc incapable de maîtriser son destin. la question de la construction de la personnalité dans la société arabe est un souci général et permanent. elle est devenue, surtout chez ses penseurs, un dilemme qu’il faut surmonter par tous les moyens. ces derniers soulèvent un certain nombre de problèmes, qui d’une façon ou d’une autre marquent une inquiétude profonde, état de pensée semblable à celui des écrivains et des philosophes arabes pendant l'époque des quatre califes et la crise de succession en particulier. ces derniers ont abandonné la question de divinité pure pour se lancer dans la critique de leur société, en particulier le problème du califat1 ou ce qu’on appelle la période de la grande discorde. malgré la différence des contextes et le temps écroulé, le sentiment de frustration qui domine tous les esprits est le même. un certain temps après l’époque des califes, les poètes, les écrivains, les philosophes …ont dénoncé certaines pratiques hallucinantes dans la société, ils choisissent alors souvent l’exil, une autre patrie où peuvent s’exprimer leurs affections et leurs attachements, le cheval, la nuit, le désert, l'ancre, l'épée et le crayon sont leurs outils par excellence compagnons des moments de paix ou de guerre contre le chef de tribu ou le chef religieux. le penseur d'aujourd'hui possède- t- il une patrie pour ses idées comme pour sa propre existence physique ? est -t- il un véritable acteur de changement dans sa société ou une simple marionnette aux mains des gens de pouvoir? et si le penseur n’a ni rôle ni statut, quel genre de savoir produitil dans sa propre société ? après avoir rappelé le lien historique entre « savoir, pouvoir et révolution » dans la civilisation arabo-islamique, les difficultés qui freinent le penseur arabe en tant qu’acteur principal dans toute réforme sociale et l’éventuel rôle qu’il peut jouer aujourd’hui, nous reviendrons sur le sens de la citoyenneté et les différents obstacles qui empêchent son acquisition dans des sociétés comme les nôtres. pour les penseurs de cette société, c’est le fondement même de l’etat qui est en question comme le type de relation à l’individu qui y vit. autrement dit, c’est cette conscience qui se forme, à travers le temps, entre l’etat de droit et le devoir de citoyen qui représente actuellement un problème majeur dans ces pays. il nous paraît également très utile de mettre en lumière le système de « parenté » qui est, à notre avis, le frein par excellence à la liberté de pensée, surtout lorsqu’il s’agit d’une société traditionnelle où la filiation dicte ses lois. les membres de la famille se sont obligés à se reconstruire selon le rythme et le mode de vie de la société. on assiste, dans la majorité des pays, à l’émergence d’un changement profond, marqué chez les uns par le silence et chez les autres par des conflits terribles. le fondement de la personnalité, au sens culturaliste du terme, et la construction de la citoyenneté, synonyme de conscience réciproque entre l’etat et le citoyen ont été, nous semble-t-il, laissés pour compte. en d’autres termes, le façonnement des individus dans leurs sociétés n’a pas subi une éducation méthodique. dans ce contexte, le penseur arabe lui aussi lié à son histoire individuelle ou sociale, n’a pas joué le rôle qui aurait pu déterminer la relation entre l’individu, la société et l’etat. les quelques rares écrivains qui ont évoqué la situation insupportable de leur pays d'origine à tous les niveaux 'ont pas abordé le problème de fond mais tourné autour de lui sans donner de véritable projet éducatif capable de transformer les revendications à une réalité réalisable. pour cette raison tout projet culturel, politique, éducatif est condamné d’avance à un échec. après avoir parlé de la personnalité en général, des problèmes qui bloquent le processus de sa construction dans la pensée comme dans la réalité du monde arabe et les leçons qu’on peut tirer des expériences des autres et comment les transmettre à nos jeunes générations dans une modernité « douteuse », nous citerons alors plus particulièrement des exemples concrets quant aux pays arabo-musulmans qui ont eu la chance non seulement d’éduquer la citoyenneté mais aussi de construire sa personnalité de demain. en effet, les pays qui ont une base plus ou moins solide dans le système éducatif sont les plus capables de s’adapter aux exigences de la vie moderne. des personnes et une personnalité, troisième chapitre de ce livre, est une ouverture sur des hommes marquant l’histoire en général de leur pays et l’histoire culturelle en particulier. ce sont à ces liens entre le caractère humain et les traits culturels qui forment le savoir faire de l’école tunisienne, que nous consacrerons notre dernier développement. des penseurs ont « transgressé, déplacé et dépassé », selon les termes de mohamed arkoun, une pensée fortement attachée à la tradition et aux normes de la société arabomusulmane. instruire les gens et construire des personnes capables de prendre le destin du pays en main est une nécessité, car l’intelligentsia de toute société constitue, à travers le temps, une référence constante. on a cru d’abord qu’il fallait former – par l’école- une minorité progressiste, et que la masse suivrait d’elle-même cette élite. le collège sadiki en tunisie, par exemple, est né pour cette mission ; dans un contexte colonial, le choix du lieu de formation et les personnes qui vont y travailler a eu pour stratégie la dégénération des indigènes et de leurs cultures. ce fut autrefois le cas, en fait, des jésuites1 qui, abandonnant en quelque sorte les adultes, impossibles à changer, leur enlevaient leurs enfants pour les instruire, dans leurs collèges, et puis, une fois christianisés, les renvoyaient dans leurs familles pour qu’ils deviennent les propres éducateurs de leurs parents. au collège sadiki, ce sont des personnalités tunisiennes qui ont manipulé les programmes et non pas l’inverse. c’est cet esprit de personnalité attaché à la fois à la tradition et à la modernité qui irrigue le système éducatif dans ce pays. les cheikhs et leurs disciples n’ont plus de place primordiale comme c’est dans les autres pays arabes où l’homme religieux est toujours le grand maître de « savoir ». l’endoculturation (endoctrinement et enculturation) n’est plus inspirée des idées écrites mais se réfère à des personnes ouvertes et universalistes. c’est une méthode socio-politique inspirée de l’action indigéniste au mexique, qui choisissait parmi les garçons d’un village ceux qui paraissaient les plus intelligents, pour les élever dans des internats afin de les soustraire de leur environnement2. evoquer le processus de construction de la personnalité nous impose de faire, au moins, deux remarques qui nous paraissent intéressantes. la première est que si la société est bien composée de groupes en inter-relations, ces groupes à leur tour sont composés d’individus et que ces individus ont des désirs, des mobiles ou des motifs d’agir, des pulsions et des rêves d’avenir, qui, s’ils peuvent être en très grande partie déterminés par la société où ils vivent, peuvent aussi varier d’une personne à une autre ; la similarité des conduites ne va pas jusqu’à l’homogénéité absolue des personnes. la seconde remarque est que la culture ne s’hérite pas, comme l’instinct dans une espèce animale, mais qu’elle est apprise, est le fruit de l’éducation et que cette éducation consiste en général à transmettre à l’enfant les normes de comportement et l’ensemble des valeurs de la société globale dans laquelle il sera amené à vivre ; mais alors également, si la personnalité d’un individu est bien façonnée par son éducation, la conclusion que l’on peut en tirer, est qu’il suffirait d’un autre apprentissage pour la modifier. pour cela, l’enfance reste le moment par excellence où peuvent être sculptées les bonnes conduites, en particulier à l’école. nous ne voulons pas, par cette démarche, effectuer une étude comparative entre les différents pays arabes mais plutôt mettre en valeur les éléments forts qui distinguent par exemple le parcours tunisien dans le domaine du savoir, lui aussi lié à une histoire et à une société. la révolution tunisienne de 2011, qui a donné l’espoir aux tunisiens, aux egyptiens, aux libyens et à bien d’autres dans le monde arabe, de vivre librement et dignement n’est en fait qu’un travail pédagogique anciennement commencé avec des personnes dont les idées ont fini par façonner le caractère particulier de la personnalité tunisienne.