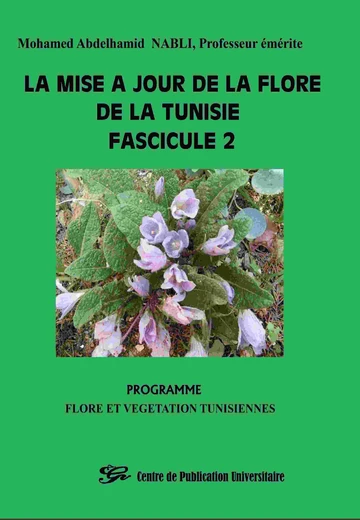La flore de la tunisie, publiée par cuenod, pottier-alapetite & labbe (1954) puis par pottier-alapetite (1979 et 1981), a dépassé le demi-siècle d’existence. des centaines d’utilisateurs compétents ont reconnu la description approfondie et détaillée taxons décrits dans cette flore. des centaines d’exemplaires des deux volumes de mme pottier-alapetite ont été vendus à l’etranger. mais depuis la parution de cette flore, de très nombreux taxons ont été découverts et, en outre, la nomenclature a beaucoup évolué surtout avec la mondialisation du savoir (*), l’utilisation de la palynologie et l’avènement de la biologie moléculaire (apports des séquençages : rbcl, cp-dna, atpb,18 sr dna, ndhf, orfk, dna...) une mise à jour taxonomique et nomenclaturale est devenue nécessaire. d’abord, une flore a un but pratique, pour reconnaître une plante sur le terrain. aussi, les subdivisions en monocotylédones et dicotylédones avec apétales, dialypétales et gamopétales ont été très utiles … et le sont encore. mais déjà, pottier-alapetite a écrit dans le volume 1 de sa flore « nous avons conservé cette vieille classification pour sa commodité. mais on verra, dans la clé des familles qui suit, que les genres de certaines familles ne se trouvent pas tous dans le même groupe ». de plus, dans les classifications phylogénétiques qui remontent à plus de cinquante ans comme celle d’emberger (1960), les subdivisions anciennes ne sont plus valables : ce dernier a écrit en 1960 : les différences entre les types des caractères monocotylédones et ceux dicotylédones sont beaucoup plus quantitatives que qualitatives. dans la flore d’egypte en 4 volumes de loutfy boulos, seules subsistent les subdivisions monocotylédones et dicotylédones avant d’être un chercheur qui peut s’intéresser à certains détails fussent-ils très importants, je suis d’abord un enseignant ayant acquis un certain bagage pédagogique. tout le monde sait que pour le non spécialiste, la détermination des plantes n’est pas chose facile. aussi, je voudrais que ceux qui ont déjà manipulé la flore de la tunisie et ont appris à s’en servir ne soient pas découragés par la nouvelle nomenclature : je maintiens la nomenclature et les textes utilisés jusqu’ici tout en ajoutant les éventuelles modifications nouvelles. de plus, la nouvelle nomenclature n’est pas contraignante comme me l’a suggéré mon ami le professeur joel mathez, un vrai systématicien montpellierain : certes, les chenopodiaceae sont incluses de nos jours dans les amaranthaceae mais si quelqu’un continue à utiliser les deux familles séparément, il ne commet pas de crime ! (*)la famille des asphodelaceae (exemple, urginea = drimia maritima) est intégrée dans celle des xanthorrhoeaceae, famille essentiellement australienne 12 enfin, certaines nouvelles classifications proposées varient avec les auteurs selon leurs critères propres : par exemple les capparidaceae sont incorporées aux brassicaceae par certains (apg, 2003) alors que pour d’autres, les capparidaceae, non seulement ne sont pas incluses dans les brassicaceae mais elles sont même scindées en capparidaceae et en cleomaceae : en tant que enseignant et pédagogue, je sais, par expérience, qu’il n’y a pas de mauvais élèves mais, peut-être, de mauvais enseignants, je refuse de faire rebuter, par des méthodes d’intégristes en systématique, toute personne débutante motivée ! a — pour faciliter la tache à ceux qui se sont déjà familiarisés avec la flore de la tunisie (les 3 volumes), je reprends ici la liste alphabétique des familles en les actualisant et ils sont libres de choisir les dénominations qu’ils souhaitent. les dénominations en caractères gras correspondent soit aux anciennes familles mais modifiées soit aux nouvelles familles, inexistantes dans la flore de la tunisie (partie i – voir fascicule 1). b — mais faudrait-il pour autant mettre de côté ce qui a été à la base de la systématique durant des décennies ? ce serait faire preuve d’adepte du système copier - coller. le mérite de cusset (1997) a été de mettre en parallèle l’ancienne classification et la nouvelle. dans celle-ci, les subdivisions, au nombre de quatorze, N'ont pas de rang taxinomique bien précis mais sont des entités naturelles et en accord avec la palynologie : grade : niveau d'évolution semblable où sont parvenus différents phylums; clade : rameau d'un phylum avec différents stades d'évolution. a titre de comparaison, je mets en parallèle la classification de cusset (1997) et celle de l’angiosperm phylogeny group (apg, 2009). dans ces deux classifications, deux familles de la flore de la tunisie ont changé de statut : les apiaceae ne sont plus incluses dans les dialypétales et les cucurbitaceae ne sont plus incluses dans les gamopétales (partie ii – voir fascicule 1). c — pour faciliter la tache à ceux qui se sont déjà familiarisés avec la flore de la tunisie (les 3 volumes), je reprends ici les clés des familles en les actualisant et ils sont libres de choisir les dénominations qu’ils souhaitent (partie iii – voir fascicule 1). d — dans ce volume va figurer seulement la famille des asteraceae = compositae comprenant près de 300 espèces. e — les localités citées dans ce volume sont simplement à titre indicatif pour indiquer leur répartition géographique et aider ceux qui s’intéressent à la phytogéographie : la plupart d’entre elles remontent à plus d’un siècle et, de ce fait, ont probablement disparu du fait de l’urbanisation et l’aménagement des routes. je prends deux exemples : 1 — en avril 2006, j’ai organisé une sortie de botanique en tunisie septentrionale pour la société botanique de france pendant une semaine ; je suis retourné dans les mêmes stations en avril 2008 : tout a disparu suite à l’urbanisation, l’élargissement des chaussées ou la construction de ponts… 2 — burollet a soutenu en 1927 une thèse d’etat, thèse la plus complète faite en tunisie, traitant du sahel de sousse, (enfidha — el jem). a cause de l’urbanisation, on ne trouvera même pas la moitié des taxons cités dans cette thèse !