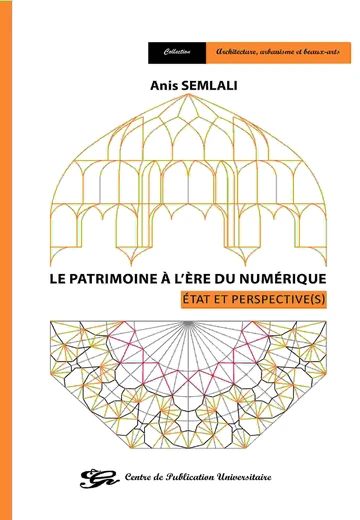Au courant des dernières décennies, le développement des moyens informatiques, combiné à l'accroissement continu de la puissance des matériels et logiciels, a abouti à une prise de conscience quant aux possibilités offertes au domaine de l'archéologie. d'une manière générale, l'emploi des technologies de l'information et de la communication (tics) s'est étendu aux divers aspects de la discipline, de la reconnaissance des sites à la publication des connaissances acquises, en passant par la cueillette, l'analyse et l'interprétation des données. au coeur de ce vaste ensemble d'applications, aux côtés des multiples recherches associant procédés informatiques et méthodes archéologiques, figure un certain nombre de projets considérant l'apport des nouvelles technologies à la présentation des vestiges architecturaux du passé, notamment lorsque ces derniers 'ont laissé que de rares témoignages de leur présence. comment ces technologies peuvent prétendre rendre à de tels restes archéologiques toute leur verticalité et leur intégrité ? voilà ce qui anime les projets de restitution du patrimoine bâti à l'aide des tics, qu'ils soient dépendants ou non d'une étude rigoureuse des multiples indices disponibles quant à l'apparence matérielle ou la structure des édifices, mais aussi quant au contexte dans lequel ils ont existé. tenter d'imaginer ou comprendre quel était l'aspect d'un édifice ou d'un site à une époque donnée est devenu une préoccupation fondamentale de l'archéologie bien avant que l'outil informatique ne soit apparu, tant sur le plan de la valorisation des vestiges du patrimoine que sur celui de la recherche. dans un souci d'envisager de manière cohérente cette démarche de restitution, ainsi que d'en dégager les caractères spécifiques, il est dans un premier temps indispensable d'évoquer les travaux préfigurant l'intervention des technologies informatiques: complétions in situ, reconstructions grandeur nature ou encore maquettes. le pouvoir d'évocation des images facilitant la représentation de ce qui 'est plus visible, les techniques d'imagerie ont été de tous temps mises à contribution de la restitution des édifices et il est apparu naturel de profiter des avancées technologiques opérées dans ce domaine. l'imagerie numérique est ainsi devenue un moyen particulièrement apprécié pour la représentation de l'apparence passée d'un édifice. la grande majorité des projets de restitution ici envisagés se limite à cet usage de l'ordinateur comme outil de représentation de bâtiments préalablement restitués. pourtant, les technologies informatiques peuvent apporter plus qu'une simple représentation d'entités concrètes ou matérielles. à ce jour, quelques groupes de recherche se sont intéressés à leur éventuelle contribution pour, non plus seulement représenter, mais aider à l'analyse et l'agencement des données encore disponibles, mais aussi comprendre et retrouver les mécanismes inhérents à la conception des édifices. l'ordinateur devient un assistant de recherche facilitant la compréhension et la restitution des édifices dans leur contexte général, illustrant ou traduisant par l'image la synthèse des connaissances acquises sur ces derniers. fruit d'un travail de recherche1 qui s'est étendu sur plusieurs années, cette présente étude vise à fournir un état de l'art de la mise en contribution des moyens informatiques à des fins de restitution du patrimoine archéologique bâti. appréhender et réunir les travaux développés à ce jour dans l'objectif de visualiser ou reconstruire virtuellement des édifices du passé sous-entend prendre en considération divers termes et concepts qui paraissent si familiers aux professionnels concernés que ceux-ci ne prennent plus le temps de les présenter, laissant, par là-même, place à une certaine confusion. ainsi, il a été à plusieurs reprises nécessaire de porter un regard plus précis sur ces notions non définies de manière précise ou uniforme, à commencer par les termes mêmes de restitution et patrimoine, mais aussi ceux de modélisation, réalité virtuelle etc... en résulte des observations qui 'ont en aucun cas la prétention d'envisager de manière intègre et définitive les diverses implications inhérentes à ces notions, ni d'oser redéfinir des concepts largement explorés par la communauté scientifique. il ne s’agit que de propositions, reflets d'une réflexion personnelle, soumises à discussions.