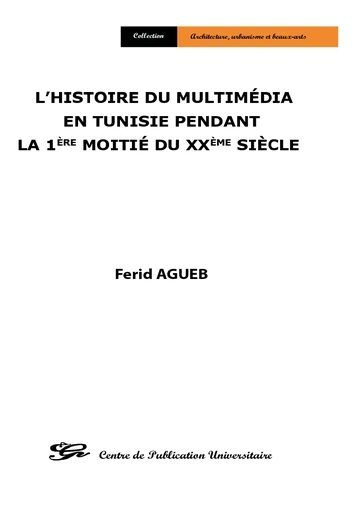L’histoire de la tunisie - terre de civilisation - est une histoire riche des faits et des idées au cours de la période ancienne, médiévale et au cours de la période moderne et contemporaine. mais la plupart des recherches scientifiques établies s’intéressent généralement à l’histoire des faits et attachent une grande importance aux détails historiques concernant les contextes spatio-temporels de déroulement de ces faits et notamment aux causes et aux conséquences. comme on remarque aussi l’importance accordée aux faits politiques et économiques par rapport aux faits sociaux et culturels, malgré la richesse de notre histoire culturelle. dans l’objectif de l’originalité et de la diversité, notre recherche est dans l’orbite de l’histoire des idées culturelles. elle s’intéresse à démontrer les rôles et les effets des créations établies dans le domaine des activités multimédia en tunisie pendant la première moitié du vingtième siècle sur le comportement, la mentalité et les relations dans la société tunisienne cependant. lorsque on essaye de distinguer entre le centre d’intérêt de l’histoire des faits et celui de l’histoire des idées on remarque qu’il s’agit d’un paradoxe. c'est-à-dire, ils se diffèrent et se ressemblent au même temps. cette conclusion nous mène vers une autre qui est la suivante : l’histoire des faits et l’histoire des idées sont deux filières de la même science, chacune a ses caractéristiques, mais elles ont des points communs. donc ces deux champs de recherche historique coexistent et ne se contredisent pas dans un équilibre entre les immuables : (l’objectivité de l’information, la démarche et l’analyse scientifiques) et les variables, qu’on n’arrive pas à fixer dans ce cadre de recherche, mais on signale les plus importantes : (les centres d’intérêt et les approches scientifiques utilisées) - l’histoire des faits se base sur les détails et sur un fait déclencheur et ayant recours à l’approche historique et scientifique essentiellement. - l’histoire des idées accorde de l’importance aux idées notamment aux nouvelles idées et leurs caractéristiques et effets sur la mentalité des individus et sur la société à tel point que les chercheurs utilisent le terme suivant « histoire de mentalités » au lieu de l’histoire des idées. ce type de recherche se base sur plusieurs approches, citons : l’approche scientifique, historique, juridique et l’approche de modernité. en s’appliquant aux exigences de notre recherche ou plutôt aux exigences de l’histoire des idées , nous accordons de l’importance aux nouvelles créations ou bien aux nouvelles idées et projets réalisés à la régence tunisienne aux niveau des activités multimédia pendant une période délicate, parmi ses faiblesses : l’analphabétisme la mentalité conservatrice l’absence de l’esprit scientifique le recours profond à la religion le refus du changement introduit par la civilisation occidentale l’histoire du multimédia(*)en tunisie pendant la première moitié du xxème siècle, fait aussi partie de l’histoire culturelle nationale. notre souci à travers cet effort consiste à la participation à la recherche scientifique objective, reflétant l’interaction de nos élites avec tout ce qui est de provenance extérieure et indiquant la coexistence entre la modernité et l’authenticité. nous signalons aussi que les recherches - d’aspect culturel - établies auparavant ont analysé les caractéristiques de la renaissance culturelle en tunisie à travers l’étude de l’histoire de la littérature et les problèmes de la langue arabe au sein de la polémique entre les élites indigènes, réservistes et modernistes : radicaux et libéraux. d’autres recherches ont évoqué l’histoire de la presse, des associations culturelles, surtout théâtrales et du cinéma à partir de premiers films réalisés par des cinéastes indigènes juifs et musulmans et dans le cadre de la collaboration artistique et culturelle entre les cinéastes, européens et arabes. on trouve également des efforts analytiques et statistiques pour les films, les acteurs et les lieux de la projection, sans recours profond à la documentation officielle, juridique et administrative à part quelques législations concernant : la presse et les associations. parmi les lois les plus traitées : celle de 1884 qui a autorisé la création des journaux et la liberté d’imprimerie et les lois de 1901 et 1936 qui ont accordé : la liberté d’opinion, d’expression et le droit au travail associatif. en réalité, notre travail s’intéresse précisément à l’histoire du multimédia et se base essentiellement sur l’approche juridique , afin de démontrer l’efficacité de toute création dans le domaine du multimédia à la régence tunisienne pendant la première moitié du xxème siècle et aussi pour dévoiler l’importance des législations ou bien du cadre législatif déterminant les caractéristiques, les fonctions, les conditions et les limites de chaque création dans le domaine signalé auparavant . notre travail ne néglige pas les autres approches de la recherche : (historique, scientifique, sociale et de modernité) mais il accorde une importance à l’approche signalée ci dessus puisque toutes les nouvelles créations étaient établies dans des cadres juridiques déterminant, leurs structures et leurs fonctions. il s’agit alors de l’autre face de la colonisation(*) française en tunisie. quelques soient les finalités et les circonstances qui ont poussé les autorités coloniales vers ces changements, les indigènes et notamment les élites ont bénéficié des faveurs de toutes les créations à court terme, et à long terme. objectivement notre effort s’ajoute aux recherches établies afin de participer à la promotion de la recherche scientifique et à sa diversité. sa spécificité se projette dans le recours profond aux textes juridiques, documents officiels et législations et la présentation de leurs contenus à caractère juridique et administratif concernant les activités multimédia adoptées en tunisie pendant la première moitié du 20ème siècle. globalement cette recherche se compose de deux parties qui se présentent ainsi : * la première est intitulée : la politique coloniale de contrôle et de censure à l’encontre des activités multimédia en tunisie durant la première moitié du 20ème siècle. * la deuxième est intitulée : l’importance des activités multimédia en tunisie pendant la première moitié du 20ème siècle. - quelles sont les caractéristiques et les démarches de la politique de contrôle et de censure à l’encontre des activités multimédia en tunisie - soumise et assujettie - pendant la période signalée ? - quelle est l’importance de ces activités multimédia cependant ?