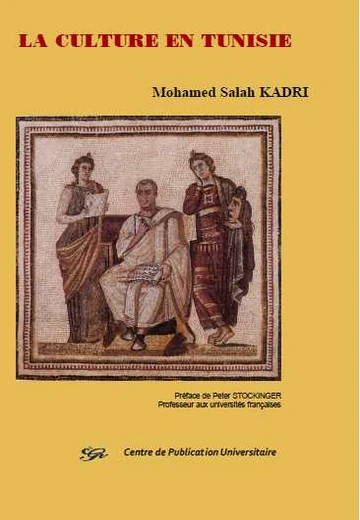Le ton change dans les médias. la presse laisse penser qu’une nouvelle ère de liberté s’ouvre à la bonne gouvernance. le vertigineux progrès que connaît le monde présent semble avoir pour toile de fond le brassage culturel. cependant, au rendez-vous du donner et du recevoir culturel, les choses semblent ne plus marcher comme elles se doivent1. les technologies de l'information et de la communication redessinent, grâce au web interactif, de nouveaux liens entre la culture et l'argent et les réseaux sociaux2 sont devenus un pouvoir incontrôlable d'information et de partage de contenus au niveau le plus large possible. "un de ses axiomes est que la croissance et l’emploi seront réalisés via de nouveaux investissements dans les industries de l'information, considérées comme étant les industries-phare de la nouvelle économie, et en promouvant l’innovation, en particulier dans la société de la connaissance3". dans cet environnement fort mouvementé, l'impératif culturel est à l'épreuve d’interrogations multiples sur la capacité des domaines de la création à préserver l'identité et générer des revenus durables pour la population. ainsi, la culture s’érige non seulement comme un facteur de transformation sociale, parce qu’elle contribue à forger l’esprit critique et l'éducation à la citoyenneté, mais aussi en guise de vrai vecteur de développement. de plus, les activités culturelles4 et créatives5 offrent des perspectives considérables en termes de croissance et d’opportunités d’emploi direct ou indirect.la nouvelle perception du "paradigme culture" semble loin d'être consensuelle, puisque la culture semble ne plus relever des domaines d’activité non productifs1. elle devient une béquille pour l'économie face au désengagement d'un "état social"2 qui est, de nos jours, le principal mécène des artistes. pour continuer à présenter une offre riche et diverse,3 l’ouverture de la culture sur le monde des affaires n’est pas à démentir. l’argument «culture, levier de développement économique» est, désormais, admis, avec des impacts qui se traduisent en créations d’emplois, de recettes fiscales et d’activités économiques. cependant, le caractère transversal et interdisciplinaire4 de la culture a réduit sa visibilité et a en quelque sorte marginalisé sa contribution au développement économique. une raison pour laquelle, les filières culturelles qui se sont développées sur des notions assez floues et des présupposés épistémologiques peu explicites, ont été jugées subsidiaires et simples moyens de divertissement. leurs capacités de générer les richesses sont restées méconnues ou plutôt sous estimées. par son potentiel d’innovation et le rôle essentiel qu’elle joue dans les processus de préparation de l’avenir de la société, la culture mérite, aujourd'hui, une place plus importante dans les stratégies de développement, comme élément associé aux politiques d’éducation, de santé, de protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire5. mais le changement ne signifie pas que l'état va perdre du jour au lendemain son statut classique de protecteur des artistes. il continuera à l'assumer sans pour autant prétendre éponger toutes les lacunes encourues par le secteur culturel1, considéré, pour longtemps "au dessus de l’argent". par ailleurs et suite à l’ouverture du marché de l’emploi aux différents secteurs, la culture, comme d’autres domaines, commence à connaitre une action de «revalorisation» dans le monde2 et en tunisie pour devenir avec l’éducation, la recherche, l’innovation, un facteur de croissance et l’une des clés de l’économie moderne sans qu’elle ne soit abandonnée à la seule loi de l'offre et de la demande. les acteurs culturels, de tous horizons, pris dans l'euphorie du marché mondial des biens culturels, essaient de s'adapter à la logique mercantile et de doper les capacités innovantes de la nouvelle économie mondiale. les spécialités culturelles se prolongent largement dans d’autres secteurs et l’étanchéité entre les professions s’y rapportant n’est pas totale. l'alliance "culture-affaires" devient incontournable et bénéfique pour tous les opérateurs du monde des arts. ainsi, les métiers en général et ceux de la culture en particulier subissent une mutation profonde due à l’usage intensif du numérique dans l’élargissement du champ de diffusion à plus grande échelle des contenus culturels. dans l'univers complexe et transdisciplinaire de la culture, un certain nombre de questions vont servir de fil conducteur à notre réflexion sur le cas de la tunisie : un pays reconnu historiquement par sa richesse patrimoniale, peut-il afficher après des décennies d'indépendance, l’image d’un "état culturel" qui se positionne de plus en plus comme une administration qui assume des missions de régulation, d’orientation, de conseil et d’expertise ou se réduit-il à un "état impresario" qui se prenait déjà pour un mécène d'avant-garde se mêlant dans la quasi-totalité des affaires du secteur ? comment l'état national arrive t-il à croiser la question de la politique et des pratiques culturelles et favoriser les synergies possibles entre champ culturel et économie ? quelles compétences pour quelle culture dans le contexte de la mondialisation et de la numérisation ? s’agit-il vraiment de secteur prometteur en offres d’emploi ou d'une discipline à la traine ? quels sont les mécanismes d'encouragement aux métiers culturels ? les subventions publiques, l’aide aux associations et la participation du secteur privé devraientelles être réhabilitées et appréhendées, en termes d’opportunités du marché des arts et d'une nouvelle économie de la valorisation du patrimoine ? quelles sont les composantes de la stratégie du développement du secteur culturel en tunisie après le 14 janvier 20111? un retour, sans instrumentalisation, sur l'histoire du pays, depuis la colonisation à nos jours, nous a paru nécessaire pour mieux faire l'état des lieux du projet culturel tunisien, comprendre ses fondements et s'interroger sur son devenir. la construction de l'avenir ne peut réussir sans lecture critique voire autocritique du passé. notre intérêt pour "la chose culturelle" nous a conduit à explorer des pistes innovantes qui pourraient compléter les voies de recherches déjà empruntées et se démarquer de celles-ci, en tenant compte de la multiplication des acteurs culturels, des exigences de la formation aux divers métiers de la culture, du nouveau rôle de l'état, de l’investissement privé et de la contribution de la société civile au développement culturel, l’application des principes de bonne gouvernance dans l’exécution des projets artistiques, outre le mode de fonctionnement des institutions culturelles et la réactivation de l’employabilité du secteur culturel. le but n’est pas de dresser un panorama global des tendances de consommation du produit culturel, mais plutôt d’en relever certaines qui nous permettront d’illustrer ce basculement de la demande, phénomène qui n’est certainement pas sans conséquence pour les institutions culturelles. de même, notre démarche s’inscrit dans le cadre de la sociologie2 des professions culturelles et se propose de dresser une cartographie des agents culturels et des métiers1 qui leur sont rattachés. pour cela, nous avons amorcé la recherche par la consultation de documents publiés et non publiés provenant de sources tunisiennes et internationales, à côté de l'analyse des données statistiques disponibles sur le sujet et la lecture des rapports d'activités du ministère de la culture pour les cinq dernières années. outre, l'exploration de travaux sur la politique culturelle, "l'approche managériale" de la culture et de ses impacts socioéconomiques. l'analyse de l'état de l'art a révélé deux tendances : - la première épouse une vision marchande de la culture prônée par l'omc : les entreprises et les économies se servent de la mosaïque des cultures et de la panoplie des éléments esthétiques et culturels afférents aux divers peuples et nations du monde pour se créer des marchés ou se réserver des niches2 d'industries de la création. - la deuxième plaide pour une souveraineté culturelle3 et de là renforcer les mesures de sa protection : selon cette conception, une révision de certaines des pratiques et croyances fondamentales d’une culture ne pourrait être possible sous peine d’en modifier l’identité de façon irrémédiable4. cependant, dans le contexte actuel et peu importe la tendance, il semble difficile de dissocier : "culture et économie". car, il n’y a pas de diversité sans échange, et la diversité culturelle est contraire à une politique de cloisonnement commerciale et géographique des cultures. les cultures 'ont pas besoin d'être protégées par les bureaucrates et les forces de police, ou placées derrière des barreaux, ou isolées du reste du monde par des barrières douanières pour survivre et rester vigoureuses. elles doivent vivre à l'air libre, être exposées aux comparaisons constantes avec d'autres cultures qui les renouvellent et les enrichissent, leur permettant de se développer et de s'adapter au flot constant de la vie1. le débat sur la culture et les industries culturelles comme vecteur de développement 'a pas suscité comme il se doit l'attention des chercheurs tunisiens toutes disciplines confondues. réfléchir en termes de politiques culturelles sur les relations entre les industries culturelles et les autres formes de création et d’animation culturelles d’origine publique et privée, N'a pas été non plus la priorité du pouvoir public. notre travail tente, selon une approche sociohistorique et informationnelle, de questionner le dispositif administratif tunisien en général et celui en rapport avec le domaine culturel particulièrement, d’analyser l’évolution de la structure de l'offre culturelle et sa segmentation en différentes disciplines2 et de focaliser la réflexion sur les aspects entrepreneuriaux de la culture3. aussi avons-nous cherché à faire une description des actifs et des emplois des professions culturelles, quel que soit le secteur d’activités dans lequel ils s’exercent. le choix méthodologique s'est fixé sur l'approche «herméneutique» pluri-méthodologique et interdisciplinaire qui se base sur la description (paradigme descriptif), l’analyse, l’explication (paradigme explicatif) et l’interprétation des données qualitatives (analyse de contenu) et quantitatives (statistiques). en outre, des entretiens exploratoires directs avec les professionnels des arts et des témoignages recueillis, croisés et confrontés avec certains acteurs culturels illustreront notre approche de la question culturelle en tunisie. sans prétention aucune, ce travail a, également, pour ambition d’offrir un ensemble d’images, de lectures mais aussi d’interprétations des données et indicateurs disponibles sur la culture en tunisie :l’histoire, la mémoire, l'état des lieux et les possibilités économiques.